Présentation
Les lépidoptères sont un ordre d’insectes dont la forme adulte, appelée imago, est le papillon . Après les coléoptères et les diptères (mouches), Il est l’un des ordres qui rassemblent le plus d’espèces. On compte à ce jour entre 15000 et 170000 espèces de papillons décrites. D’après les spécialistes, 7000 d’entre elles vivraient en Europe et plus de 5000 en France . Mais chaque année de nouvelles espèces sont décrites, même s’il s’agit pour la plupart de tous petits papillons. Les plus gros, bien visibles, sont connus et répertoriés depuis longtemps.

Origine
Les lépidoptères comme les trichoptères sont les deux branches issues du super-ordre des Amphiesmenoptera qui est apparu sur terre il y a 250 millions d’années. C’est dire que les papillons ne datent pas d’hier. Le fossile de papillon le plus ancien est Archaeolepis Mane. il date de 190 millions d’années. Ses écailles et ses ailes fossilisées ont été découvertes dans le sud de l’Angleterre par le géologue James Frederick Jackson (1894–1966)
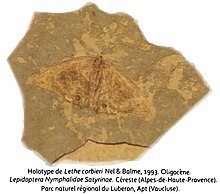
Familles
On a recensé aujourd’hui près de 134 familles de papillons dans le monde . ce nombre n’est pas définitif et il est tout à fait possible que d’autres familles soient découvertes dans les années à venir .
les principales familles de papillons de jour (rophalocères) que l’on peut rencontrer en France sont :
1) Les Nymphalidae
Les Nymphalidae sont la plus grande famille de papillons diurnes avec 542 genres et plus de 6000 espèces répertoriées et décrites dans le monde .
Ils comptent dans leur rang quelques-uns des plus beaux papillons comme les monarques ou les morphos.
En France on compte plus de 130 espèces comme le Paon du jour (Aglais io) , le vulcain , la petite tortue (Aglais urticae) la belle dame (vanessa cardui) , la carte géographique (Araschnia levana), le petit mars changeant (apatura ilia) ou le Robert le diable (Polygonia c album) .

Cette famille est divisée en 12 sous-familles. (Apaturinae, Biblidinae, Calinaginae, Charaxinae, Cyrestinae, Danainae, Heliconiinae, Libytheinae, Limenitidinae, Morphinae, Nymphalinae, satyrinae.)
Certaines de ces sous-familles étaient autrefois considérées comme des familles distinctes, mais des traits communs ont permis de les réunir sous la même dénomination.
Les Nymphalidae sont de taille moyenne et ont souvent des ailes vivement colorées . Ils ont également la première paire de pattes atrophiée et couverte de poils qui ne sert pas à marcher. . Les ailes antérieures possèdent également toujours 12 nervures . Les antennes des Nymphalidae sont aussi longues que le corps et portent 3 arêtes. On dit qu’elles sont tricarénées.
La famille des Nymphalidae a été decrite en 1815 par le naturaliste et archéologue américain d’origine Franco italienne, Constantin Samuel Rafinesque.
2) Les Papilionidae
Les papilionidés sont une famille de lépidoptères qui comptent 600 espèces connues dans le monde . La plupart des espèces qui font partie de cette famille sont des grands papillons diurnes. Ils portent généralement des couleurs vives , ont un vol vigoureux et certains ont une queue qui prolonge les ailes postérieures. La majorité des papillons de cette famille vivent sous les tropiques et l’on trouve parmi eux des papillons de très grande taille comme l’Ornithoptère de la Reine Alexandra. La femelle de cette espèce est connue pour être le plus grand papillon diurne. Elle peut avoir une envergure 28 cm.
11 espèces vivent en Europe. les papillons les plus connus de cette famille sont le machaon , la diane, le flambé ou l’ apollon.

Les Papilionidae se distinguent des autres familles par quelques différences anatomiques.
Les chenilles possèdent un osmeterium sur le dessus de la tête. Cet organe érectile qui sort de sa cache à la moindre alerte a la forme d’une langue de serpent et dégage une forte odeur censée repousser les prédateurs .
La deuxième nervure anale sur l’aile postérieure atteint le bord de l’aile alors qu’elle fusionne avec la première dans les autres familles .
Les écailles cervicales se rejoignent sous le cou.
Les 6 pattes sont fonctionnelles chez les deux sexes.
La famille des Papilionidae a été créé en 1802 par l’entomologiste Français pierre Henri Latreille .
3) Les Pieridae
La famille des Piéridae regroupe plus de 2000 espèces dans le monde. Plusieurs espèces sont migratrices et ont ainsi pu se répandre largement dans le monde. La plupart des Pieridae ont une couleur de fond blanche ou jaune, mais certaines espèces ont des couleurs très vives voire des zones transparentes sur les ailes. En Europe on peut trouver une cinquantaine d’espèces qui font partie des papillons les communs et les plus connus. Qui n’a jamais entendu parler des piérides du chou et de la rave, du citron, du souci ou de l’aurore dont le mâle illumine nos printemps avec son petit soleil.

Les Pieridae sont caractérisés par des particularités anatomiques.
Leurs chenilles sont vertes . Les chrysalides sont presque toujours attachées par le crémaster et une ceinture de soie. Leurs œufs sont cannelés et en forme de quille. Les adultes n’ont pas de palpes maxillaires et leurs yeux sont arrondis.
Les mâles ont souvent des andrologies sur le bord des ailes postérieures.
Il existe souvent un dimorphisme très net marqué par la couleur ou par des taches noires.
Etc.
La famille des Pieridae a été créée en 1820 par l’entomologiste anglais William Swainson. D’autres sources en attribuent la paternité à l’entomologiste français Philogène AugusteJoseph Duponchel qui l’aurait, lui, crée en 1935 .
4) Les Lycaenidae
Les lycénidés sont une famille de lépidoptères qui compte plus de 6000 espèces dans le monde , une centaine en Europe et près de 65 en France . On pourra ainsi croiser dans l’exagone des papillons comme l’argus bleu (Polyommatus icarus) , le collier de corail (aricia agestis) , l’azuré des nerpruns (Celastrina argiolus)ou le Thècle de l’yeuse (Satyrium ilicis).

De petites tailles, les adultes sont généralement colorés. Le dessus des ailes comporte des écailles qui provoquent de belles iridescences. Cette particularité se retrouve dans les noms vernaculaires de certaines espèces comme les azurés ou les cuivrés. Il existe souvent un dimorphisme qui fait que les mâles portent des couleurs vives alors que les femelles restent dans des teintes plus neutres et moins visibles. Le dessous des ailes est plus terne .Les antennes plutôt courtes sont collées aux yeux . Ces derniers sont souvent entourés par une bande d’écailles blanches . Ils n’ont pas de palpes maxillaires .
La famille des lycénidés a été décrite et crée en 1815 par l’entomologiste britannique William Elford Leach.
Elle est divisée en sept sous-familles :
les Aphnaeinae
les Curetinae
les Lycaeninae
Les Miletinae
Les Polyommatinae
Les Poritiinae
Les Theclinae
5) Les Hesperiidae
Les hespéridés sont une famille de lépidoptères qui regroupe plus 4200 espèces dans le monde. La plupart d’entre elles vivent dans la région néotropicale. Une trentaine d’espèces vivent en Europe dont 28 en France. Parmi les Hespéridés que nous pouvons rencontrer dans l’hexagone il y a la sylvaine, l’Hespérie de l’Alcée ou l’Hespérie de la mauve.

Les Hespéridés sont des papillons robustes de petites tailles. La teinte est généralement brune avec des marques claires. Certaines espèces tropicales présentent néanmoins des couleurs plus vives. D’autres ont une petite queue qui prolonge les ailes antérieures.
Parmi les traits qui les caractérisent, on peut noter les antennes qui se terminent par une pointe recourbée vers l’arrière ainsi qu’une tête presque aussi large que l’abdomen . Ils ont aussi la particularité d’avoir des caractères propres aux hétérocères et aux rhopalocères. Ils maintiennent notamment les ailes à la verticale la nuit ou lorsqu’il fait sombre alors que les hétérocères les maintiennent à plat. Mais le jour lorsqu’ils sont actifs, certains maintiennent les ailes postérieures à l’horizontale et les antérieures relevées, alors que les rhopalocères les gardent tous à la verticale.
Les hespéridés sont aussi connus pour avoir une vision supérieure aux autres papillons grâce à une plus grande distance entre les ommatidies* et les cellules sensorielles. Cette particularité augmente la résolution et la sensibilité de leur vue et leur permet d’effectuer des figures en vol d’une grande précision..
La famille des Hesperiidae a été décrite par l’entomologiste français Pierre André Latreille en 1809.
Les principales familles de papillons de nuit (hétérocères) que l’on peut trouver en France sont :
- Les Zygènes (Zygène de la filpendule, zygène fausta, zygene de la coronille, etc…)
- Les Hyponomeutes(Hyponomeute du pommier, Hyponomeute du fusain, Hyponomeute du cerisier, etc…)
- Les Geomètres (L’alterné, le céladon, La phalène picotéen, l’éphyre trilignée, La petite boarmie crépusculaire))
- les Sésies (Sésie apiforme, Sésie bembex, Bembecia ichneumoniformis, etc…)
- Les Pyrales (Pyrale du buis , pyrale de la lyuzerne, pyrale de l’ortie, etc…)
- Etc…
Parmi les hétérocères deux tiers sont des « Microlépidoptères » que le grand public appelle d’un seul mot « les mites ». le dernier tiers est constitué par les « Macrohétérocères ».
Quelques chiffres
Papillons de jour et papillons de nuit représentent 9 pour cent de toutes les formes de vie qui existent sur terre . Mais un chiffre est encore plus intéressant et surprenant : Si l’on prend en compte tous les papillons qui existent, ceux qui vivent le jour ne représentent que 5 pour cent . Tous les autres, soit 95 pour cent, sont des papillons de nuit . Voilà un chiffre qui devrait nous faire réfléchir sur la différence, souvent très grande, qui existe entre ce que l’on croit ou voit et ce qui est vraiment.
Autre détail qui devrait, lui, nous faire réfléchir sur la valeur de notre jugement esthétique . Les papillons les plus évolués ne sont pas comme on pourrait l’imaginer les plus beaux ni les plus colorés mais ceux qui font partie de la famille des noctuelles. Les membres de cette famille vivent pour la plupart la nuit et nous les trouvons en général très laid, voir sans aucun intérêt (sic).
Caractéristiques
Comme son nom l’indique lépido (écaille) et ptères (ailes) , le mot lépidoptère désigne l’ordre qui regroupe l’ensemble des insectes qui ont des écailles sur le corps et notamment sur les ailes. On ne les voit pas forcément à l’œil nu, mais les écailles des papillons apparaissent très nettement dès qu’on utilise un fort grossissement. (illustration ).
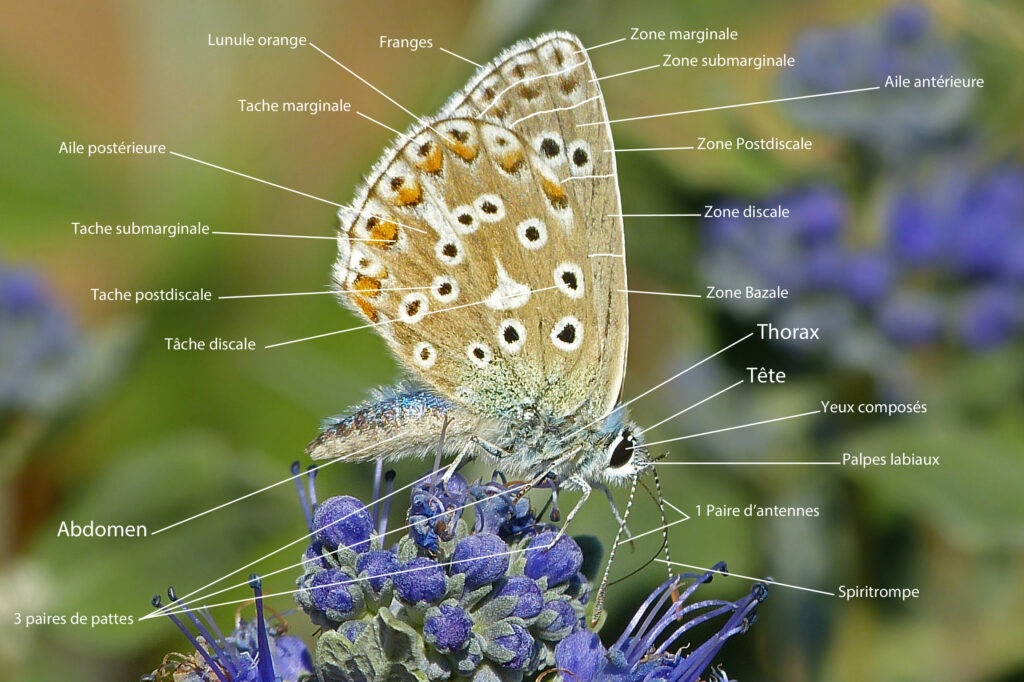

D’autres particularités les caractérisent comme d’avoir :
Deux paires d’ailes membraneuses recouvertes d’écailles
Trois paires de pattes.
Ils sont aussi des insectes holométaboles.
C’est-à-dire que leur développement passe par un développement complet qui va de l’œuf à la larve (la chenille chez le papillon) puis à la nymphe (chrysalide chez le papillon) puis à l’imago (version adulte du papillon).
Rhopalocères ou hétérocères
Le système de classement général des animaux est dû au naturaliste suédois Linné (1707-1778). Celui-ci créa « la classification binominale » qui permet de décrire les espèces en deux noms. Le nom générique qui définit le genre et l’épithète qui la qualifie.
Au début de la classification, Linné plaçait toujours les lépidoptères dans le genre « papilio ». Puis d’autres naturalistes prirent le relais et créèrent de nouveaux genres ainsi que des familles qui permettaient de rassembler les papillons qui avaient des caractéristiques communes.
c’est ainsi que sont nés les 2 sous-ordres des rhopalocères et des hétérocères qui étaient censés représenter, d’un côté les papillons de jour, et de l’autre les papillons de nuit.
Proposés par le médecin et entomologiste français Jean Baptiste Dechauffour de boisduval, ils furent employés pendant de très nombreuses années pour classer les papillons. Ils sont encore utilisés par commodité aujourd’hui, bien qu’ils soient considéré comme faux et dépassés par les scientifiques.
Ce classement s’effectuait en fonction de la morphologie des antennes.
Rhopalocères
Dans le sous-ordre rhopalocère étaient classés les papillons dits « de jour ». Comme l’indique leur nom qui vient du grec « rophalon » massue et de « keras » corne , il rassemblait les papillons qui avaient des antennes en forme de Massue.
Hétérocères
Dans le sous-ordre hétérocère étaient classés les papillons dits « de nuit » qui était en réalité tous les papillons qui n’avaient pas d’antenne en forme de massue. D’où leur nom Hétérocère qui signifie en grec : celui qui a des antennes (keras) autre ou différent (Hétéro).
Cette classification a été abandonnée, car elle avait de très nombreux défauts.
Le principal reproche était que de nombreux papillons dits « de nuit » vivaient aussi le jour et que l’on pouvait également rencontrer des papillons de jour, la nuit . Pour rattraper le coup, les scientifiques les baptisèrent les « hétérocères diurnes » , c’est-à-dire les papillons de nuit qui vivent le jour.
Un autre défaut était que les rhopalocères avaient été regroupés ensemble parce qu’ils créent un vrai groupe avec des espèces apparentées entre elles alors que les hétérocères avaient été classés ensemble pour la simple raison qu’ils n’avaient pas d’antennes en forme de massue. Le résultat était qu’a part cette maigre caractéristique ils étaient très différents et n’avaient, pour la plupart, aucun lien de parenté entre eux .
Ces catégories battaient vraiment trop de l’aile (c’est le cas de le dire) et pour toutes ces raisons elles n’ont plus cours aujourd’hui dans le milieu des lépidoptéristes (papillonistes*).
Je n’irais pas trop loin dans les explications qui deviennent très complexes et réservées aux spécialistes, mais les papillons sont aujourd’hui divisés en deux sous-ordres principaux.
les zeugloptera qui regroupent des papillons assez primitifs qui ne possèdent pas de trompe, mais des mandibules avec lesquels il broie les grains de pollen et les glossata dans lequel on retrouve la plupart des espèces qui ont une trompe et qui se nourrissent de jus par aspiration.
Deux autres petits sous ordres ne regroupent que quelques papillons.
Les Heterobathmiina qui comprennent la famille sud américaine des Heterobathmiidae, représentée par seulement 9 espèces et Les Aglossata sont représentés par une seule famille, les Agathiphagidae. Cette famille ne compte qu’un genre , Agatiphaga et 2 espèces .
L’appareil buccal
Les lépidoptères se caractérisent aussi par un appareil buccal de type suceur (à l’exception de quelques rares espèces dites archaïques) .
Ils se nourrissent en effet grâce à une trompe (spiritrompe), plus ou moins longue selon les espèces, qui leur permet d’aspirer les sucs et les nectars des plantes.
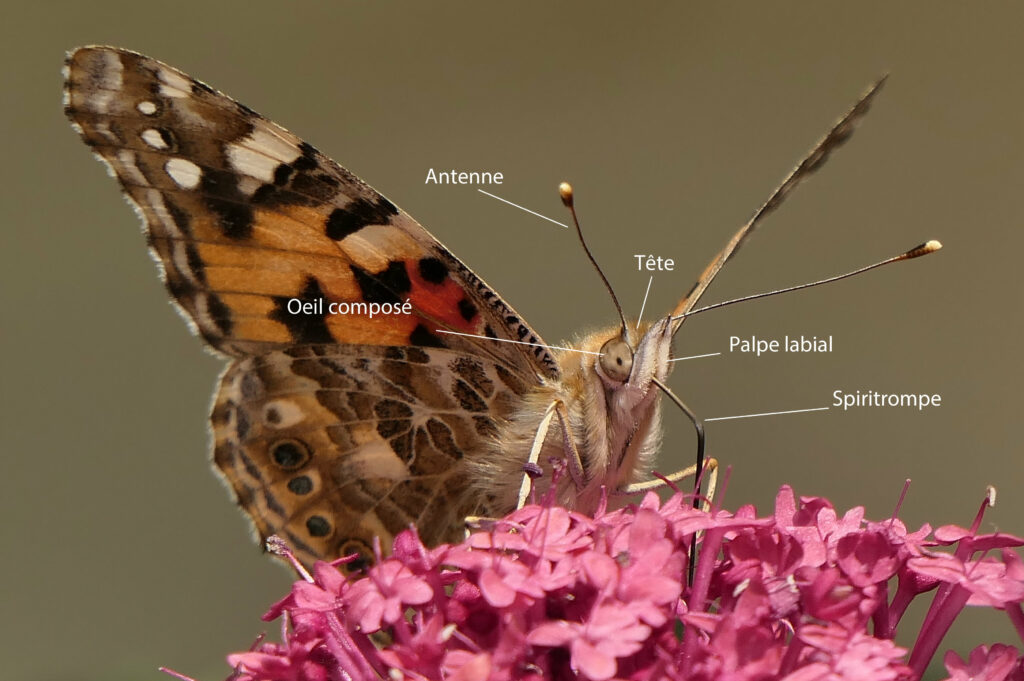
La Trompe
La trompe, appelée aussi spiritrompe ou proboscis, s’insère entre les 2 les palpes labiaux. Ces derniers ont pour fonction de la protéger lorsqu’elle est replié à l’état de repos. Ils sont également recouverts de capteurs qui détectent les odeurs de nourriture. Certains spécialistes pensent qu’ils pourraient aussi jouer le même rôle que les moustaches du chat et qu’ils permettraient de détecter, par effleurement, des dangers que les yeux ne peuvent pas voir.
Les yeux
Deux gros yeux composés se trouvent de chaque côté de la tête. Chacun peut compter jusqu’à 15000 facettes appelées ommatidies. L’ensemble donne au papillon une excellente vision en mosaïque sur 360 degrés. Comme les punaises, les libellules et de nombreux insectes, les papillons peuvent aussi avoir des yeux simples nommés (ocelles) qui servent à la stabilité du vol et sont aussi des capteurs de lumière. Les yeux simples sont moins visibles que sur les guêpes ou les mantes religieuses en raison des poils qui recouvrent souvent la tête des papillons. Contrairement à d’autres insectes qui peuvent avoir jusqu’à trois ocelles, les papillons n’en ont jamais que deux, un de chaque côté de la tête et jamais d’ocelle médian.
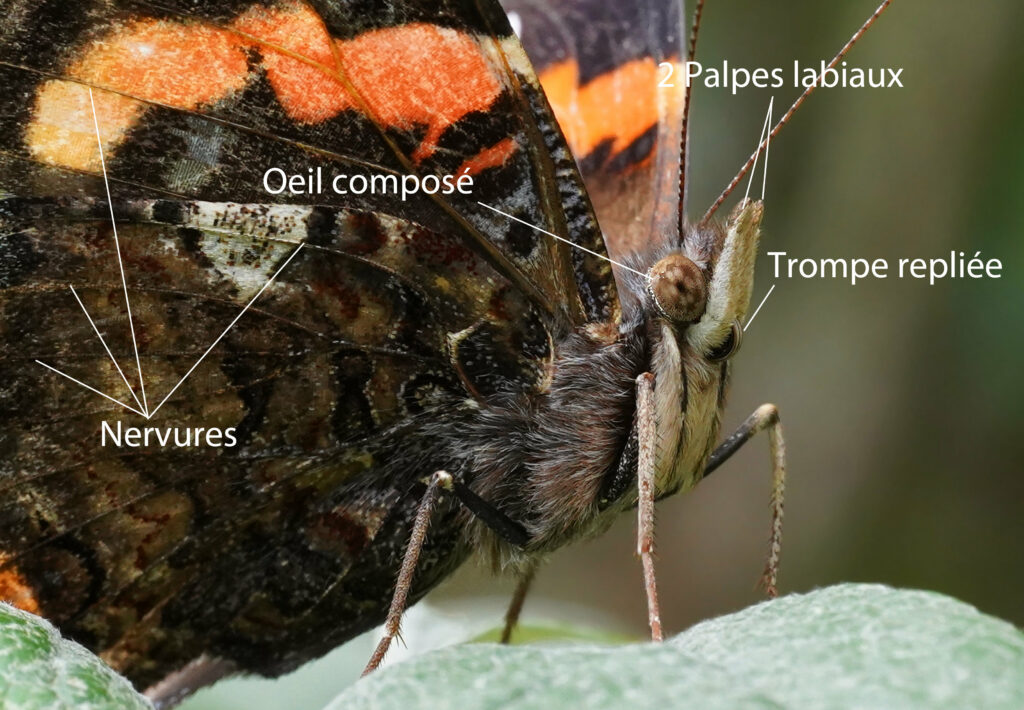
Les antennes sont fixées juste au-dessus. Elles peuvent être orientées dans plusieurs directions et sont recouvertes par de nombreux capteurs. Elles jouent un rôle très important dans la vie du papillon et sont de véritables radars sensoriels capables de détecter les prédateurs ou les autres animaux en mouvement , les phéromones sexuelles ou les effluves de nectar . Les mâles de certaines espèces comme les saturnides les ou les lasiocampides ont des antennes bien plus larges en forme de peigne ou de râteau couvertes de centaine de milliers de capteurs qui sont capables de détecter les phéromones des femelles a plus de 2 km . Elles servent aussi à la communication tactile . Lorsqu’on observe les papillons, il n’est pas rare d’en voir les utiliser pour toucher ou frôler d’autres lépidoptères.

Différentes formes d’antennes (Photo google)
La taille et leur forme diffèrent selon les familles des papillons. Grâce à elles, on peut distinguer les papillons dits diurnes ( rhopalocères) qui ont des antennes qui se terminent par une massue arrondie. Seule exception à la règle, les hespéridées dont les massues se terminent par une sorte de petite virgule.
Les hétérocères diurnes ou papillons dits de nuit (bien que beaucoup vivent aussi le jour) ont des antennes aux formes plus variées qui peuvent être en forme de peigne, sétiforme, filiforme unipectinée, bipectinée filiforme. Mais la nature ne se laisse jamais emprisonner dans des généralités et il aussi existe des hétérocères diurnes qui ont des antennes en forme de massue (Zygènes).
L’organe de Johnson se trouve au pied de chaque antenne . Celui-ci a pour fonction de détecter la position des antennes et d’aider à leur orientation. Il sert également à la stabilité et à l’orientation lors du vol. D’après des études récentes effectuées sur le monarque, l’organe de Johnson serait capable de détecter le champ magnétique et servirait notamment pendant les migrations .
Corps
Le corps est composé par le thorax et l’abdomen .
Le premier se compose de 3 segments qui servent d’ancrage pour les ailes et les pattes. À l’intérieur, de puissants muscles permettent aux papillons de voler. On imagine leur force quand on sait que les ailes battent au rythme de 5 à 10 battements par seconde. Les membres de la famille des hespéridées détiennent le record avec 20 battements Secondes. C’est déjà très bien, mais les papillons ne sont pas les plus rapides à ce petit jeu. À titre de comparaison, une chauve-souris bat des ailes 16 fois /secondes, l’abeille 230 fois /secondes, le moustique 600 fois/ secondes et le grand gagnant est le minuscule moucheron Forcipomya qui peut battre des ailes plus de 1000 fois par seconde.
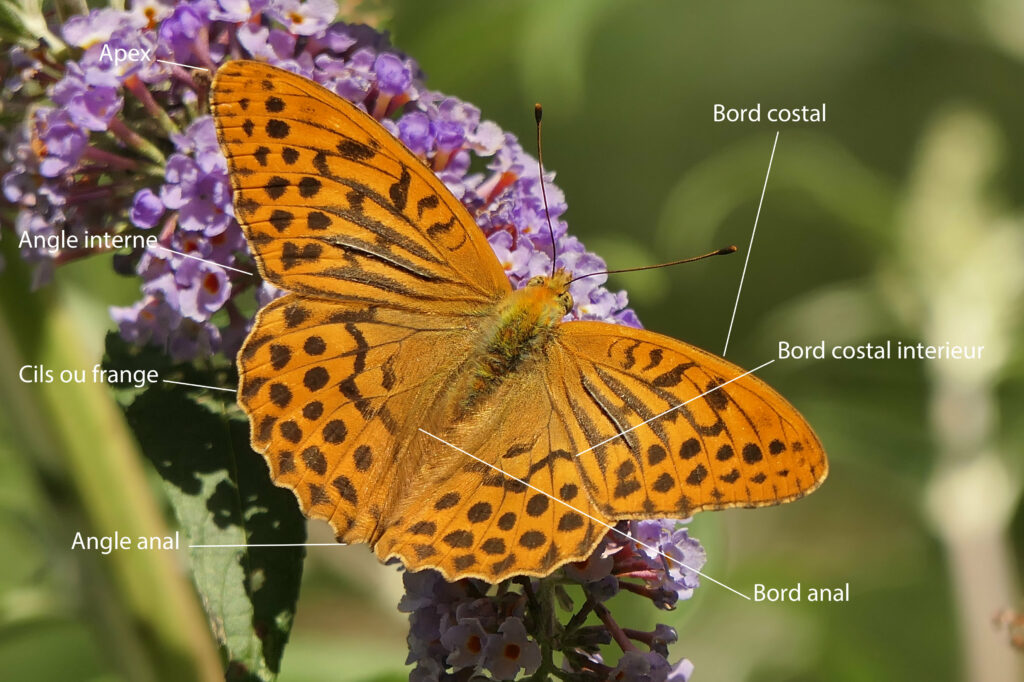
L’abdomen, lui, est cylindrique . Il est constitué de dix segments faits de chitine et reliés entre eux par des tissus souples qui permettent la souplesse nécessaire pour l’accouplement et la ponte.
il contient la plupart des organes comme le tube digestif , les spiracles qui relié à de minuscules sacs font office de poumons, ainsi que les organes génitaux.
Les lépidoptères possèdent tous 2 paires d’ailes (à l’exception de quelques espèces aptères*) . Ce sont elles qui nous émerveillent quand nous voyons passer un papillon .
Chaque aile est composée d’une double membrane dont la rigidité est renforcée par des nervures creuses qui partent de la base de l’aile . Les plus grosses contiennent des vaisseaux où passent eau et oxygène ainsi que des nerfs qui sensibilisent l’ensemble. Les nervures et leurs nombres varient selon les espèces, mais le principe reste le même . Elles sont parfois cachées par les écailles qui recouvrent les ailes, mais on les voit très bien chez certaines espèces comme le Gazé ou certains papillons aux ailes transparentes. La forme des nervures du papillon est souvent caractéristique de la famille auquel il appartient . Elle est l’un des éléments qui permettent l’identification. Les nervures portent toutes un nom suivant l’emplacement où elles se trouvent .

Les membranes sont transparentes, mais elles sont recouvertes, chez la plupart des papillons, par des écailles qui ont donné leur nom à l’ordre .
Ces écailles ont la forme de tuiles plates ou de gouttes et sont agencées en quinconce comme les tuiles d’un toit . Elles recouvrent les ailes, mais recouvrent également le corps et leur patte voire leur trompe et leurs antennes . Leur forme varie selon l’endroit où elles se trouvent pour s’adapter à la fonction qu’elles vont avoir . Elles peuvent être adaptées pour le vol et l’aérodynamisme ou renforcées pour la protection de certaines parties plus fragiles comme l’abdomen ou les parties génitales . Les écailles-tuiles sont constituées de chitine, une molécule naturelle qui a de nombreuses vertus comme la légèreté , la robustesse, la souplesse ou l’hydrophobie l’imperméabilité qui permet de pouvoir continuer à voler un temps malgré la pluie de rester au sec carapace de nombreux insectes et mollusques sont faires de chitine.
Androconies
Les androconies sont des écailles glandulaires souvent regroupées en touffe sur les ailes des mâles. Lors des périodes de reproduction, elles émettent des phéromones sexuelles qui attirent les femelles. Chez certains mâles, elles apparaissent sous la forme de bandes noires ou de zones luisantes sur le dessus des ailes.
Les femelles dégagent aussi des odeurs pour attirer les mâles par des glandes situées au bout de l’abdomen. Ces odeurs sont très puissantes et peuvent attirer de nombreux mâles qui les sentent à de grandes distances.



Dimorphisme
Il existe plusieurs caractéristiques qui permettent de distinguer les mâles des femelles . Les femelles sont souvent un peu plus grandes que les mâles. Elles ont également les ailes plus arrondies et possèdent un abdomen plus épais qui est adapté pour contenir les œufs. Comme chez les oiseaux et de nombreuses autres espèces, les femelles ont également très souvent des teintes bien plus discrètes que les mâles. Cette différence vient de ce que le mâle a besoin d’être vu de loin par la femelle au moment de la reproduction alors que les femelles doivent rester discrètes pour pouvoir mener à bien la ponte sans être repéré par les prédateurs .


La différence est parfois très légère, mais il en existe un grand nombre ou elle est très marquée comme chez l’argus bleu ou le petit mars changeant.
l’hémolymphe
Contrairement à nous , les insectes n’ont pas vaisseaux sanguins et donc pas de sang . Celui-ci est remplacé par l’hémolymphe dans lequel les organes baignent directement. De couleur verdâtre ce liquide remplit de nombreuses fonctions comme apportés des nutriments, évacuer les déchets , lutter contre les infections ou les éléments pathogènes, etc… Injecté sous pression lors de la sortie de la chrysalide c’est lui qui permet au papillons de déplier ses ailes. Le zoologiste allemand Herman Landois est le premier à s’être intéressé à ce l’hémolymphe en 1864.
Cycle des papillons
Comme les diptères, les hyménoptères ou les coléoptères, les lépidoptères sont des insectes holométaboles. On dit aussi parfois qu’ils sont des insectes Endoptérygotes, c’est-à-dire que leur cycle biologique passe par 4 stades dont 3 où ils ont une forme différente de celle de l’adulte . Pour cette raison, Linné a baptisé « imago » le dernier stade, car l’insecte est enfin à l’image de ses parents.
Ces 4 stades sont :
- l’œuf dans lequel l’embryon se développe .
- La larve, appelée chenille chez les lépidoptères, qui se développe en plusieurs mues .
- La nymphe, ici nommée chrysalide, ou s’opère la métamorphose (stade nymphal)
- Le stade adulte, appelé aussi imago comme je l’ai expliqué ci-dessus.
Le principal avantage apporté par ce système vient de ce que chaque stade a son type d’alimentation et que les uns n’épuisent pas les ressources alimentaires des autres .
L’embryon se nourrit de l’intérieur de l’œuf , la chenille de sa plante hôte, la nymphe, elle, ne mange pas et l’adulte se nourrit avec sa trompe du nectar des fleurs ou de la sève des arbres (voir partie alimentation du papillon).
Anna Maria Sibylla Merian
Le cycle de vie en 4 stades a été découvert et mis en avant par la peintre allemande Maria Sibylla Merian. C’est elle aussi qui découvrit, grâce à ses observations minutieuses, de nombreux autres détails touchant à la vie des papillons et des insectes . Elle fut la première notamment à comprendre que les femelles papillons pondaient sur certaines plantes dont dépendaient leurs chenilles. Pour le dire plus simplement, elle découvrit que chaque espèce de papillons a ses plantes hôtes et que les chenilles de ces espèces ne se nourrissent que de certaines plantes .
(Photo de Maria et du cycle des papillons avec l’image du thysiana agripini)
Détail du cycle des papillons
1 ) Les œufs
Les œufs portent en eux tout le devenir de l’insecte. Chez les lépidoptères les formes et les couleurs sont infinies et varient selon les espèces ou les sous-espèces . Ils peuvent être sphériques ou ovales comme la plupart des œufs, mais peuvent aussi avoir des formes plus aplaties, en forme de cône, de ballon de rugby ou de bouteilles . Les motifs ou les alvéoles qui se trouvent dessus peuvent prendre eux aussi les formes les plus étonnantes. De tous les insectes, les papillons sont ceux qui ont les formes d’œufs les plus variés.
Grâce à ces différences les spécialistes sont capables de dire l’espèce et souvent aussi son stade en observant la forme l’ emplacement ou la couleur des œufs .
Les œufs peuvent être blancs , roses, jaunes ou verts, mais ils peuvent prendre des teintes plus sombres juste avant l’éclosion . On peut d’ailleurs parfois apercevoir l’embryon juste avant l’éclosion à travers le chorion* devenu translucide.
La taille des œufs n’est pas forcement en rapport avec la taille du papillon. De gros papillons peuvent pondre de tout petits œufs et inversement. Pour ce qui concerne les espèces que nous pouvons voir en France ou en Europe, la taille peut aller de 0.3 mm à 3 mm. Leur diamètre diminue au fur et à mesure que la femelle vieillit, car ces réserves nutritives se réduisent.
Les œufs sont déposés en groupe ou isolément par la femelle sur ou à côté de la plante hôte qui deviendra la nourriture principale de la chenille. Habituellement , la femelle les colle sur le revers des feuilles pour qu’ils restent invisibles des prédateurs et qu’ils soient aussi à l’abri du soleil ou de la pluie, mais la nature étant ce qu’elle est on peut toujours trouver des exceptions à cette règle. Chez certaines espèces, la dépose est moins délicate. Les femelles « larguent » leurs œufs à proximité de la plante hôte comme un bombardier larguerait ses bombes .On se doute qu’avec cette technique approximative il doit y avoir un peu plus de casse.

Lors de la ponte, la femelle fait attention à repartir les œufs en fonction de la quantité de nourriture disponible pour que chaque chenille puisse se nourrir convenablement. Le manque de feuilles amènerait forcément au décès des chenilles . Certaines espèces sont cannibales et les individus finiraient par se manger entre eux s’il n’y a plus assez de nourriture.
Une fois qu’elle a pondu la femelle s’en va et ne s’occupe plus de sa descendance qui devra se débrouiller seule.
Pour la femelle, trouver la bonne plante n’est pas chose facile. Mais les papillons sont dotés d’organes extrêmement sensibles qui leur permettent de ne pratiquement jamais se tromper. Des zones comme les antennes ou les pattes sont notamment pourvues de nombreux capteurs qui informent le papillon sur le gout, l’odeur ou la texture d’une plante. On a longtemps cru que les femelles papillons retrouvaient les plantes parce qu’elles reconnaissaient les plantes sur lesquelles elles s’étaient nourries à l’état de chenilles, mais cette explication ne vaut pas pour toutes les espèces .
Dans son ouvrage très complet sur les papillons d’Europe, Michael Chinery* cite le cas de l’azuré des nerpruns dont la génération estivale de chenilles se nourrit sur le houx, mais qui une fois atteint le stade du papillon (l’imago) pond sur le lierre . On voit bien ici que la mémoire ne joue aucun rôle et que les papillons ont donc d’autres moyens que nous ignorons mais qui leur permet d’identifier à coup sûr leurs plantes hôtes.
Il arrive aussi que les œufs soient déposés dans des endroits où il n’y a pas la plante hôte. Cela arrive quand le temps ne permet pas de voler ou quand la femelle, malgré tous ses efforts, n’a pas réussi à trouver les bonnes plantes aux alentours . Prise de cours, elle doit alors se délester de ses œufs sur la première plante venue. La plupart des papillons réabsorbent leurs œufs lorsqu’ils se rendent compte de l’erreur qui condamne leur descendance . D’autres les laissent sur place et re-pondent plus tard sur la bonne plante .


En général les œufs sont pondus en grand nombre pour compenser les conditions climatiques et les prédateurs qui en détruisent beaucoup . Une femelle peut en pondre 200 en une seule fois et plus de 1000 au cours de sa vie.
La taille des œufs diminue au fur et à mesure que la femelle vieillit, car ces réserves nutritives se réduisent .
Les œufs des papillons possèdent une petite dépression sur le dessus où se trouvent un ou plusieurs trous (les pores micropylaires) par lequel entre le sperme lors de la fécondation. On appelle cette zone le micropyle . La coquille de l’œuf est également remplie de pores microcosmiques , les aéropyles*, par lesquels l’air peut entrer pour oxygéner la chenille en formation .
L’embryon se nourrit grâce aux réserves nutritives contenues dans l’œuf. En temps normal, Il faut de une1 à 2 semaines pour que la chenille soit entièrement formée et prête à sortir de l’œuf . Il faut beaucoup plus de temps lorsque l’espèce hiberne au stade de l’œuf et que l’embryon doit alors passer plusieurs mois enfermé dans sa coquille . Le développement est alors ralenti pour que l’éclosion puisse se dérouler aux premiers jours du printemps.
Les œufs destinés à passer l’hiver sont souvent plus gros et possèdent un chorion plus épais . Ils peuvent également contenir du glycérol qui fait office d’antigel ou être recouverts d’écailles déposées par la femelle au moment de la ponte .
*Chorion
Enveloppe externe de l’œuf.
*Mycropyle : Petite zone avec un ou plusieurs trous par lequel le spermatozoïde entre pour venir féconder l’œuf. Après la pénétration le micropyle se referme pour bloquer la venue d’autre spermatozoïde.
*Aéropyles : Canaux tout autour de l’œuf qui traversent le chorion des œufs d’insectes qui permettent l’oxygénation de la chenille en formation.
2 ) les chenilles
Après avoir découpées une partie du chorion pour sortir de l’œuf, les chenilles se mettent en quête de nourriture. Normalement, la mère a pondu les œufs sur la plate hôte et les chenilles n’ont pas un long chemin à faire pour prendre leur premier repas . L’activité principale des chenilles consiste d’ailleurs à se nourrir et elle le font très bien. Une chenille affamée peut dévorer une feuille complète en quelques minutes . Étant paysagiste de métier j’ai pu voir à plusieurs reprises des buis totalement défoliés en 1 nuit. Je quittais le domicile du client avec des buis en parfait état et lorsque je revenais le lendemain toutes les feuilles des arbustes avaient été dévorées par les chenilles de la pyrale du buis qui sont particulièrement voraces et souvent nombreuses.

Le style avec lequel les chenilles attaquent les feuilles peut permettre l’identification. Certaines espèces font des trous d’autres s’attaquent aux bordures alors que d’autres , comme la pyrale du buis, ne laissent rien derrière elles .
La nourriture des rhopalocères est essentiellement constituée de plantes à fleurs et notamment des feuilles bien que certaines espèces puissent s’attaquer à d’autres parties comme la tige , les fleurs ou les fruits .
L’alimentation des hétérocères est plus variée et ceux-ci peuvent aussi consommer des mousses, des fougères, les lichens ou les aiguilles des conifères.
Cette accumulation d’aliment a pour fonction de fournir l’énergie nécessaire aux diverses mues que la chenille va devoir traverser et en fin de cycle à sa transformation en papillon. Durant la nymphose le papillon ne prend plus aucune nourriture et la chenille doit parvenir à ce stade rempli d’Énergie pour être capable d’effectuer la grande métamorphose.
Le corps des chenilles est fait pour manger. Il est constitué d’une tête faite d’une capsule dure de chitine, de mâchoires très puissantes et d’un long corps mou traversé par un long intestin .
Si l’on entre un peu dans le détail, on peut dire que la chenille est constituée de 3 parties . La tête, le thorax et l’abdomen.
1 ) la tête est dotée de mâchoires très puissantes de type broyeur, d’une filière qui servira au filage de la soie , de palpes labiaux, de très courtes antennes et d’ ocelles, ou stemmates, qui sont des yeux simples qui ne permettent pas de voir des images, mais donnent des informations sur la luminosité . ceux-ci au nombre de 12 sont disposés de chaque côté de la tête (6 de chaque côté)
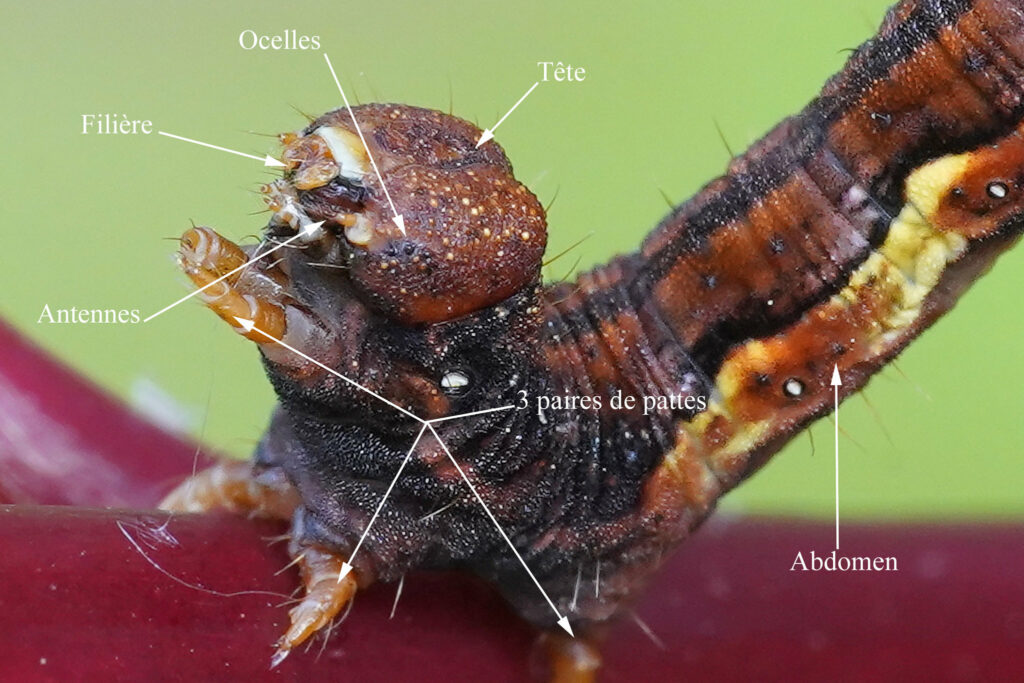
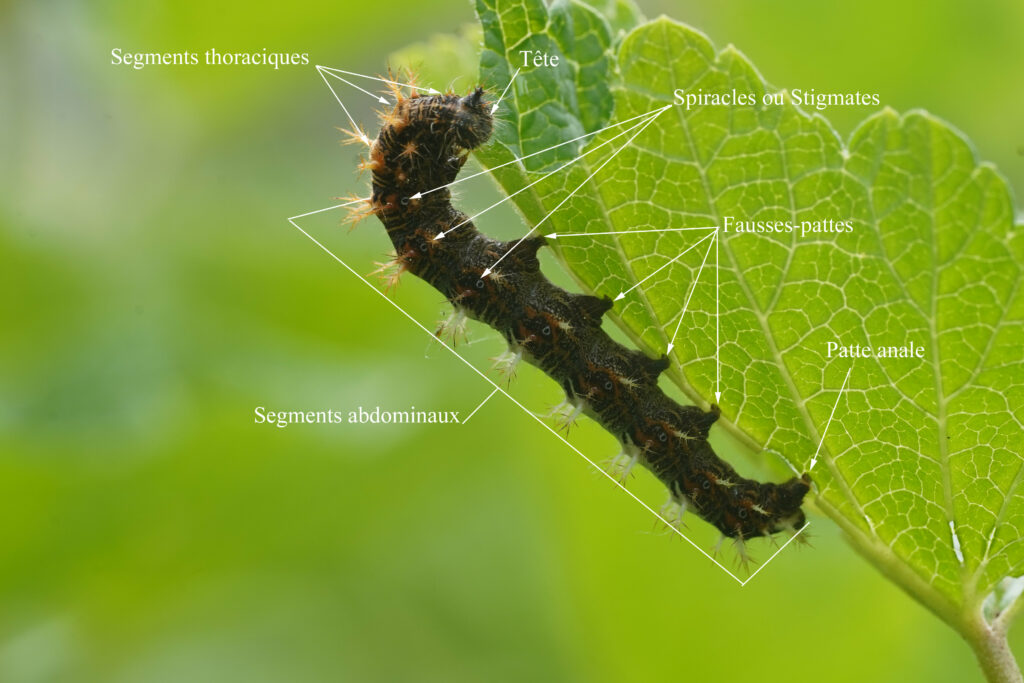
2 ) le thorax correspond aux trois premiers segments qui suivent la tête. Chaque segment porte une paire de vraies pattes articulées qui se terminent chacune par une griffe unique . Celles-ci servent plus à la chenille pour s’accrocher que pour se déplacer .
3 ) L’abdomen est composé de 10 segments ou anneaux charnus . Les segments 3 à 6 sont souvent dotés de fausses-pattes* et le dernier segment d’une autre paire de pattes dite anale .
Ces pattes sont munies de crochets ou parfois de ventouses et servent au déplacement de la chenille.
S’il y a une paire de fausses pattes abdominales plus une paire anale il s’agit de la famille des Geometridae.
S’il y a deux paires de fausses pattes abdominale plus une paire anale il s’agit de chenilles qui font partie de la sous famille des Plusiinae et des Catolinae (certaines seulement).

Tous les autres espèces de papillons ont 4 paires de fausses pattes abdominales plus une anale.
La respiration se fait grâce des petites ouvertures nommées spiracles ou stigmates qui sont situés de chaque côté du corps . En général, on en trouve 1 paire par anneau, mais il peut y avoir des différences selon les espèces . Les stigmates fonctionnent comme des valves et ne s’ouvrent que lorsque la chenille a besoin d’oxygène.
Certaines chenilles sont recouvertes de touffes de poil ou de petite épine qui ont des vertus défensives . La chenille processionnaire par exemple est recouverte de milliers de poils qui sont comme des minis aiguilles. Non contents d’être piquants, ses poils contiennent aussi une protéine toxique qui est très irritante et qui décourage un grand nombre de prédateurs.

Phytophages ou carnivores ?
En Europe, la plupart des chenilles sont phytophages et se nourrissent de végétaux. Certaines, comme celles de l’azuré du serpolet et quelques espèces qui lui sont proches, ont un régime carnivore sur la fin de leur cycle.
De nombreuses espèces phytophages peuvent en revanche pratiquer le cannibalisme à l’occasion quand la nourriture vient à manquer.
Mais il existe dans le monde et notamment sous les tropiques un certain nombre de lépidoptères de la famille des lycaenidae dont les chenilles sont carnivores du début a la fin de leur évolution. Ces chenilles se nourrissent de petits animaux comme les pucerons, les cochenilles ou les membres de la famille des homoptères.
La mue
Les chenilles n’ont pas de muscles . La forme du corps n’est due qu’à la forme de la peau qui est gonflée par la pression de l’hémolymphe dans lequel baignent les organes . Pour cette raison la chenille doit changer de peau et muer lorsqu’elle grandit. Une nouvelle peau , plus grande, se développe alors sous la première. Une chenille peut effectuer 4 à 5 mues au cours de son développement .
Pour exécuter cette mue qui va l’exposer, la chenille choisit un endroit tranquille , s’immobilise et cesse de manger. Elle gonfle alors la région antérieure de son corps en faisant pression avec son hémolymphe et déchire l’ancienne peau devenue trop petite. Celle-ci se fend d’abord sur la partie arrière et la chenille s’en extrait en progressant vers l’avant .
Il est impossible de déterminer le sexe des chenilles à l’œil nu, car elles ne possèdent pas d’organes génitaux . Seule une analyse génétique le permettrait .

Très lente dans leur déplacement, les chenilles sont des proies faciles et très recherchées par les oiseaux et de nombreux autres prédateurs . Pour cette raison certaines chenilles ont des tenues de camouflage (cryptique) qui imite la couleur des feuilles ou la texture du bois .
Je suis passé à de nombreuses reprises devant cet arbuste avant de repérer cette chenille de la phalène qui s’était immobilisée sur cette branche dont elle a la couleur même la forme (mimèse) .
Camouflage
Pour se défendre des prédateurs, les chenilles adoptent le camouflage . « Adopte » est une façon de parler puisque cette homochromie avec le milieu qui les rend quasiment invisibles se fait par le biais de la sélection naturelle et non par une quelconque volonté de l’animal.
Les chenilles qui ont des teintes proches de leur plante hôte sont tout simplement moins mangées et moins parasitées et peuvent davantage transmettre leurs gènes que celles qui ont des tons plus criards.
La couleur des chenilles est donc souvent le vert ou le marron, car ces couleurs sont les plus fréquentes dans la nature. La couleur dépend surtout des teintes de la plante hôte sur laquelle la chenille va passer le plus clair de son temps. Pour renforcer l’illusion, la couleur est rarement uniforme. Beaucoup ont des stries ou des rayures obliques qui viennent casser les formes de l’animal .

Camouflage (Photo Google )soldat avec maquillage
Les militaires qui ne veulent pas être vus des ennemis utilisent la même technique en revêtant des vêtements vert et marron et en se dessinant des lignes obliques sur le visage pour brouiller la lecture. Des chenilles comme celle du Flambé (iphiclides podalirius) ou du Grand mars changeant (Apatura iris) jouent sur deux tableaux en utilisant des lignes obliques et en ayant des formes qui les font ressembler à des feuilles enroulées.
Ce dernier type d’imitation par un animal d’une forme de la nature est appelé mimèse.
La chenille de la nymphale de l’arbousier et celle de la mélitée du plantain sont des parfaits exemples de mimèse . Le corps de la première imite parfaitement la feuille de l’arbousier tandis que le corps de la seconde imite par la forme et les couleurs, les épis du plantain.
Certaines phalènes peuvent même changer leur couleur en fonction de la tige sur laquelle elle se trouve. Des zones plus ou moins sombres sur la chenille jouent aussi un rôle de protection en brisant l’effet de l’ombre qui peut trahir une présence. Parmi les autres éléments de dissimulation, on peut aussi nommer la pilosité qui est parfois si importante qu’on devine à peine ce qui se cache dessous.
Soies
Les chenilles tissent de la soie pour plusieurs raisons.
La première est qu’elle permet aux chenilles de fabriquer un cocon dans lequel elles pourront opérer la nymphose .
Une autre raison est que la soie leur permet de se protéger des prédateurs, mais aussi des excès climatiques comme la pluie, le froid ou la chaleur .
La soie permet aussi de garder un taux d’humidité acceptable autour de l’animal .

De nombreuses espèces de chenilles, comme l’hyponomeute du fusain ou la chenille processionnaire du pin tissent de grandes toiles protectrices dans lesquelles elles vivent en groupe et dont elles sortent lorsque qu’elles souhaitent aller grignoter une feuille .
Qui a un fusain ou des pins chez soi a pu déjà apercevoir ces cocons protecteurs .
Les chenilles excrètent la soie par des filières situées sur la lèvre inférieure. La filière est reliée aux glandes séricigènes qui produisent la soie. Au début semi-liquide, la soie se solidifie lorsqu’elle entre en contact avec l’air.
Le fil est composé de deux brins semi-liquides extrudés* par les deux glandes qui sont liés ensemble lors de leur passage dans la filière . La fusion des deux fils se fait grâce à la séricine, une colle naturelle secrétée par la chenille.

Le Bombyx du murier
La soie la plus (tristement) célèbre est celle qui est produite par le bombyx du murier et qui sert à la fabrication des étoffes.
Inutile de dire que je suis absolument contre ce type d’exploitation des chenilles qui sont élevées à la chaine puis ébouillantées ou gazé pour que le cocon ne soit pas déchiré,
Paul McCartney disait : «Si les abattoirs avaient des murs en verre, tout le monde serait végétarien »
Je suis sûr pour ma part que les amateurs de soie seraient très surpris et surement moins enthousiastes s’ils savaient comment leur foulard a été produit et combien d’êtres vivants ont dû tué pour le réaliser. Il faut tuer 3000 chenilles pour obtenir 250 grammes de fil de soie. On mesure d’ailleurs là à cette occasion toute la futilité du monde de la mode qui ne s’attache qu’à l’apparence et qui n’a la plupart du temps aucun respect du vivant. Peu importe s’il a fallu tuer des vaches, des lapins, des visons, des crocodiles, ou ébouillanter et gazer des milliers de chenilles pourvu que ça brille et que cela fasse riche.
(je ferais très bientôt un article sur le sujet)
3) La chrysalide
Après l’œuf et la chenille, la chrysalide est la troisième étape dans le cycle de développement des papillons . Elle est la phase de diapause pendant laquelle la chenille se transforme en papillon.
Parvenue à sa maturité, la chenille cherche alors un endroit où elle pourra effectuer cette phase dans les meilleures conditions. Cela peut être sur la tige de la plante hôte elle-même ou enterrée dans le sol au pied de cette même plante.
Parmi celles qui se fixent à une tige, quelques-unes s’attachent tête en bas (Tircis ou petite tortue) en tissant un coussinet de soie au niveau du crémaster alors que d’autres, comme le machaon ou l’Aurore, gardent la tête haute et confectionnent une ceinture qui va les maintenir solidement au support. On appelle ces dernieres les chrysalides ceinturées .
Un certain nombre de chenilles vont effectuer un parcours parfois assez long et périlleux avant de trouver le bon endroit.
La chenille du Machaon peut par exemple entreprendre un voyage de 2 à 6 heures avec de se fixer sur un support. Cette migration a des avantages des inconvénients . L’inconvénient est que la chenille est plus visible pendant son cheminement. l’avantage est que les prédateurs ne la trouveront pas sur sa plante hôte où ils ont l’habitude d’aller la rechercher .

Une fois installée, la transformation à proprement parler commence . Vu de l’extérieur on a l’impression que la chrysalide est au repos et qu’il ne se passe rien . Mais c’est l’inverse qui se produit et à l’intérieur se déroule une intense activité qui va remodeler la chenille en papillon. Un insecte qui rampait va devenir un magnifique papillon qui vole .
La chenille cesse alors de boire et de se nourrir et vide son tube digestif puis effectue une mue qui fait apparaitre la chrysalide.
Une grande partie des tissus de la chenille subissent à ce moment-là une importante transformation qui permet de faire apparaitre le corps et les ailes du futur papillon. Pendant cette étape la chrysalide, qui est immobile, est extrêmement vulnérable. Beaucoup sont victimes des prédateurs qui en font leur repas ou qui viennent y pondre leurs œufs (parasitoisme ). Un certain nombre de lépidoptères, pour cette raison, fabriquent en plus de la chrysalide un cocon protecteur . Celui-ci peut ressembler à une coque faite de soie ou à un rouleau de feuilles . Les papillons de nuit sont connus pour fabriquer de tels cocons .
Contrairement aux papillons les chrysalides sont peu visibles et revêtent souvent des formes et des couleurs proches de la nature qui font qu’elles se confondent avec leur support. Mais la cause se comprend bien et c’est là un moyen de défense pour compenser leur immobilité qui les empêche de fuir ou de se défendre .
Les chenilles qui arrivent à maturité en fin d’automne et qui passent l’hiver à l’état de chrysalide chercheront un endroit bien abrité pour supporter les froidures de l’hiver . Certaines chrysalides peuvent résister à des températures très basses entre – 25 et -30 grâce à la présence de produits antigel dans leurs tissus (glycol).
Quelques jours avant la sortie du papillon, la chrysalide change de couleur et on aperçoit alors parfaitement la forme des ailes . Les motifs des ailes de la belle dame, par exemple, sont parfaitement reconnaissables quelques heures avant la délivrance.
L’émergence du papillon se fait grâce à un apport d’air qui gonfle le corps du papillon. L’épiderme de la chrysalide se déchire alors au niveau de l’arrière de la tête . L’insecte libère d’abord ses pattes , ses antennes puis le reste de son corps . Les papillons qui avaient un cocon de protection devront aussi se délivrer de ce dernier .
Chrysalidation d’une petite tortue

Au jardin des oiseaux, J’ai eu la chance d’assister à la chrysalidation d’une petite tortue (Aglais urticae). La chenille s’est d’abord fixé sur une citerne d’eau grâce à des fils de soie qu’elle a tissé puis elle a pris une position en L . Je m’attendais à ce qu’elle reste ainsi pendant deux ou trois jours, mais dès le lendemain la chrysalidation avait commencé. La chenille s’était débarrassée dans la nuit de sa cuticule et avait entamé la nymphose.


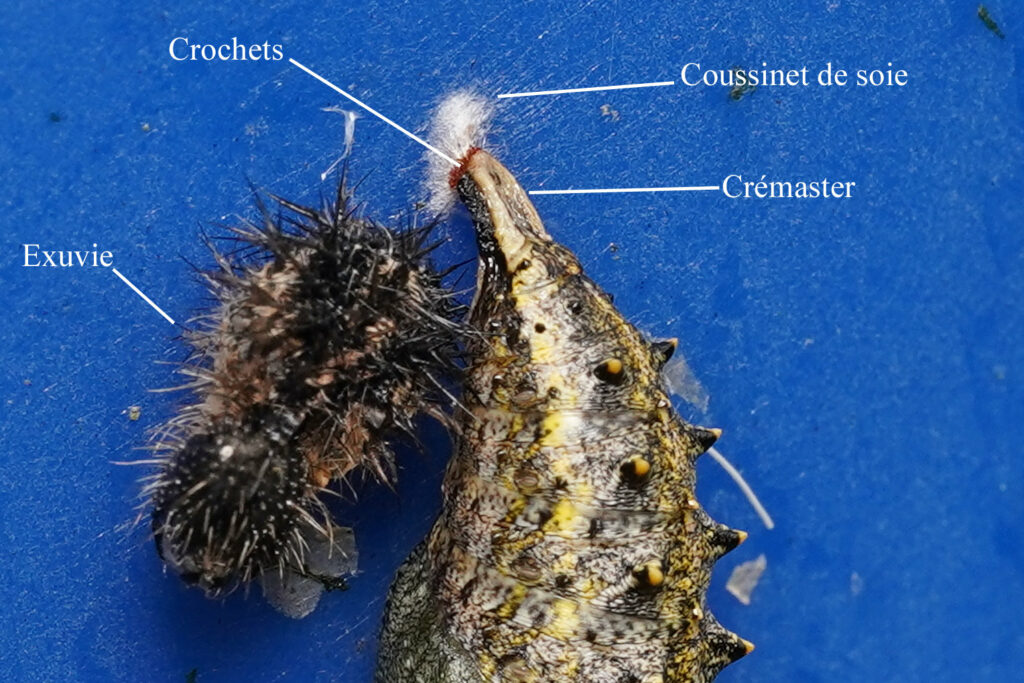
La chrysalide se libère de la vieille peau grâce à des contractions abdominales . Celle-ci est repoussé vers l’arrière et reste repliée et séchée au « pied » de la chrysalide . on voit bien sur ma photo l’exuvie replié où l’on peut encore lire l’emplacement de la tête et du corps de la chenille.
Les chrysalides sont en apparence totalement immobiles et la plupart le sont, mais certaines peuvent bouger . C’est le cas de la chrysalide de la petite tortue qui s’est mis à bouger de gauche à droite lorsqu’une personne qui m’accompagnait s’est approchée d’un peu trop près . Il ne s’agit pas bien sûr de grands mouvements, mais des observations ont montré que les chrysalides se servaient de ces petits mouvements latéraux pour tenter de repousser les prédateurs.
Le mot chrysalide vient grec ancien « Khtusallis » qui signifie doré . Au départ il a été créé pour désigner les chrysalides de certaines espèces de Nymphalidae qui ont des reflets métallisés.
4 ) L’adulte
Linné a nommé le 4 -ème et dernier stade du cycle des papillons Imago car le papillon est enfin à l’image de ses parents .
Juste après l’éclosion, le papillon s’installe dans un endroit où ses ailes encore molles peuvent pendre et il y injecte de l’air et de l’hémolymphe* pour les gonfler et durcir les nervures . il lui faudra encore attendre entre 1h et 5 heures pour celles-ci soit entièrement sèche et qu’il puissent s’envoler .
La dernière phase consiste en l’éjection du méconium qui est le fluide fécal accumulé lors de la métamorphose .
Méconium vient du grec « mekonion » qui signifie suc de pavot
Chez les insectes il a souvent une couleur rosée voir rouge vif qui peut être pris pour du sang .
Selon certaines sources l’éjection de méconium rouge par les papillons à certaines périodes serait à l’origine de la légende des pluies de sang qui avaient cours au moyen âge .

Dans la vie des papillons d’Europe de Denis richard et Olivier Maquart, on trouve un extrait d’une chronique publiée en 1608 qui relate ce phénomène qui avait traumatisé les villageois .
« Une pluie de sang tomba à Aix-en-Provence et s’étendit à une demi-lieue de la ville . L’effroi était dans tous les esprits . Heureusement un homme instruit, M de Peiresc, se livra sur ce soi-disant prodige à des recherches assidues. Il reconnut que les matières rouges qui existaient dans l’eau de pluie n’étaient autre chose que les excréments de papillons qu’on avait observés en abondance sans les commencements en juillet . Il s’empressa de montrer le fait aux amis du miracle, mais le peuple des faubourgs continua de ressentir une véritable terreur à la vue de ces larmes sanglantes qui tachaient le sol de la campagne ».

L’enquête prouva en effet que toutes les taches rouges qu’on trouvait aux alentours du village étaient dû à un nombre impressionnant de vanesse qui s’étaient libérées en même temps de leur méconium .
Les papillons sortis de la chrysalide sont maintenant entièrement tournés vers un seul objectif : survivre pour pouvoir se reproduire avant de disparaitre . Leur durée de vie assez courte fait qu’ils n’ont pas le temps de se consacrer à des futilités et que mâles comme femelles s’attellent à cette tâche avec un grand sérieux dès l’émergence à l’état adulte . Si on peut badiner avec l’amour, on ne badine pas avec la perpétuation de l’espèce quand cette dernière peut disparaitre chaque printemps .
Thermorégulation
Les lépidoptères sont des animaux ectothermes. C’est-à-dire qu’ils ne produisent pas leur propre chaleur comme la plupart des oiseaux et des mammifères, mais qu’ils sont dépendant pour cela du climat extérieur .
S’il fait trop froid, ils ne pourront voler et mourront s’il ne trouve pas rapidement un abri ou qu’il ne migre pas .
S’il fait trop chaud, ils se déshydrateront et mourront de la même manière . Pour cette raison de nombreuses espèces hibernent en hiver ou effectuent des migrations vers les pays plus tempérés .
Pour lutter contre ces variations de température, ils ont développé des stratégies qui leur permettent de compenser les températures excessives.
Pour lutter par exemple contre les fraicheurs matinales, les papillons ouvrent les ailes pour capter le moindre rayon de soleil. Pour optimiser encore plus la chaleur, ils se placent sur des supports de couleur claire qui réverbère la chaleur et leur chauffe le dessous du corps. Ces supports peuvent être des troncs d’arbres clairs comme les bouleaux ou les peupliers ,de simples feuilles tombées au sol ou même des bouts de plastique . Cette pratique est très développée chez les papillons et on peut l’observer presque chaque matin à l’heure où les papillons rechargent leurs « batteries » .
Certaines fleurs lumineuses, de couleur jaune par exemple, peuvent également jouer ce rôle . Le papillon fait ainsi d’une pierre deux coups . Il se nourrit en aspirant le nectar tout en profitant au mieux de la luminosité qui le réchauffe du dessus, par le soleil, ou du dessous, par la réverbération..
J’appelle ces zones des reposes papillons.



Par temps chaud, ils font l’inverse. Ils gardent les ailes fermées ou se mettent à l’ombre . Ils ressortent en début de soirée lorsque l’air est un peu plus frais . Ils cherchent également à boire en buvant dans des flaques, des piscines ou sur le bord des rivières.
Si la canicule se prolonge, certains entrent en diapause comme ils le font en automne. La diapause d’hiver s’appelle l’hibernation . la diapause d’été, l’estivation. Cet état leur permet de ralentir leur métabolisme et de supporter les très fortes chaleurs.
D’autres reprennent la route et migrent vers des régions où ils trouveront les températures adaptées à leurs organismes . C’est ce que font d’ailleurs les très nombreux papillons d’Afrique du Nord qui entreprennent une grande migration au début du printemps pour venir s’installer en France, et jusqu’au nord de l’Europe, où les températures sont plus tempérées qu’en Afrique. .
La température idéale pour la plupart d’entre eux se situe entre 20 et 28 degrés.
Climatisation
Des études récentes ont montré que les papillons étaient capables de refroidir leurs ailes grâce à une sorte de climatisation interne . Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les ailes ne sont pas que des structures mortes. Elles sont alimentées en liquide via les nervurations principales. Les scientifiques ont également montré que les ailes avaient une sorte de cœur très primitif qui battait une dizaine de fois par minute pour faciliter la circulation de l’hémolymphe dans les nervures et les androconies. Les écailles participent aussi à la climatisation en réfléchissant ou en absorbant le rayonnement solaire selon les besoins du papillon.

La teinte de certaines parties du corps jouerait également un rôle. Les couleurs sombres permettraient aux papillons vivant dans des pays plus froids d’absorber un maximum de chaleur alors que les couleurs claires permettraient aux papillons des pays chauds de repousser les rayons du soleil.


Alimentation
1) Le nectar
Avec un appareil buccal de type suceur*, les papillons ne peuvent aspirer que des substances fluides. Le nectar des fleurs qui se trouve dans les nectaires de ces dernières constitue l’élément principal de leur alimentation.
Les papillons butinent les fleurs grâce à leur trompe qui joue le même rôle que nos pailles . La sélection naturelle, chère à Darwin, joue ici son rôle et elle a fait en sorte que la longueur des trompes de chaque espèce correspond à la profondeur des corolles dans lesquelles les papillons aiment butiner .

C’est en voyant que le nectar de l’orchidée Angraecum sesquipedale se trouvait au fond d’un éperon de 26 cm que Darwin a émis l’hypothèse qu’il devait exister un papillon qui possédait une trompe de cette taille . Il précisa que ce papillon était certainement le seul à pouvoir polliniser cette plante en raison de la longueur de l’éperon.
Darwin n’eut pas la chance de pouvoir vérifier son hypothèse de son vivant . Il mourut en 1882 .La réponse fut apportée 20 ans plus tard en 1903 par les entomologistes anglais Walter Rothschild et Karl Jordan . Ces derniers décrivirent une sous-espèce du sphinx de Morgan capturé par le naturaliste français Paul Mabille à Madagascar qui correspondait parfaitement à la prédiction de Darwin. Le papillon avait une trompe de 27 centimètres qu’il enroulait autour de sa tête en faisant plus de 20 tours quand il ne l’utilisait pas.
C’est à l’occasion de ce butinage que le corps du papillon se recouvre du pollen des fleurs et qu’il va ensuite le déposer sur d’autres fleurs qu’il pollinise .
Certains papillons sont « généralistes » et butinent de nombreuses espèces, mais d’autres sont spécialisés et ne butinent que certaines fleurs avec des caractéristiques bien précises (Couleurs, forme , taille, type de nectar, odeur , etc. …).
On sait par ailleurs que certains papillons vont naturellement vers les premières plantes qu’ils ont rencontrées juste après leur émergence. on retrouve cela chez de nombreuses especes animales et notamment chez les humains qui restent souvent très attachés au type de nourriture que leurs parents leur proposaient lorsqu’ils étaient enfants .
Les papillons qui vivent en sous-bois se nourrissent également, comme les fourmis, du miellat des pucerons qui sont souvent très nombreux sur le feuillage des arbres.
Depuis les années 70, les entomologistes avaient remarqué que les fleurs qui attiraient le plus les papillons étaient des fleurs dont le nectar était très riche en acide aminé. Des expériences récentes menées sur une série de plantes ont pu expliquer ce phénomène . Elles ont notamment démontrer que les acides aminés étaient très importants pour le bon développement des papillons et que ceux qui avaient eu accès à des plantes riches en acides aminés avaient plus d’œufs que les autres et que leurs œufs étaient en « meilleure santé » que ceux qui avaient du se contenter de plantes plus pauvres.
Parmi les plantes naturelles, l’origan, les cardères , les salicaires, les fleurs de prunelliers ,l’ortie, l’eupatoire chanvrine, la menthe ou la ronce sauvage sont des plantes qui ont un grand succès auprès des papillons . Pour ce qui est des plantes élaborées par les humains, il suffit de regarder un jardin au printemps ou à l’automne pour voir que les asters, les sedums , l’aubriète, les échinacées ,la centranthe rouge, la verveine de Buenos Aires , le buddleia ou le lierre les attirent aussi fortement .
2) Sèves et sucs
Même s’il est l’élément principal, le nectar n’est pas le seul aliment dont se nourrissent les papillons . Des espèces comme le maure (Mormo maura ), la grande tortue (Nymphalis polychloros), le Sylvandre (Hipparchia fagi), le Morio (Nymphalis antiopa) ou le Tircis (Parage aegeria) se nourrissent de la sève qui s’écoule des arbres et des sucs des fruits.
Mettez une coupelle de fruits pourris dans votre jardin et vous verrez surement apparaitre le petit mars changeant qui se nourrit principalement de jus de fruits .

disputent une poire dans la coupelle aux papillons.
Au jardin des oiseaux, je n’en voyais jamais jusqu’au jour où j’ai eu l’idée d’installer une coupelle à papillons remplis de fruits pourris (Poires, pêches, abricots , melon , etc.) Depuis, le jardin est habité chaque année par cette espèce que l’on repère immédiatement grâce au phénomène de l’iridescence qui fait apparaitre de grandes zones bleues sur les ailes des mâles.
3) Urine, transpiration, excrément ou charogne
Mais les papillons se délectent également d’aliments moins nobles que les fruits ou le nectar . Il apprécient aussi beaucoup les excréments, l’urine ou les charognes dont ils extraient, grâce à leur trompe, les éléments nutritifs . Ils font la même chose avec les eaux boueuses ou la transpiration . Si un papillon, un jour, se pose sur votre bras en été, n’y voyez pas comme cause un signe du destin ou la force attractive de votre charisme . le papillon est simplement en train d’extraire les sels minéraux de votre transpiration pour s’en nourrir . Les mâles s’intéressent notamment au sodium contenu dans ses solutions pour le transmettre ensuite, via le spermatophore, aux femelles.


*Quelques rares *groupes de papillons n’ont pas de trompe et se nourrissent en raclant le pollen avec des petites mandibules . D’autres n’en ont pas parce qu’ils ne vivent que quelques heures et que leur durée de vie limitée leur laisse juste le temps de se reproduire.
Reproduction
Comme toutes les espèces vivantes sur la planète, les papillons n’ont qu’une seule obsession : ne pas disparaitre et « persévérer dans leur être » comme l’écrivait si joliment le philosophe Spinoza en son temps.
Mais contrairement aux autres espèces , la vie des papillons est très courte et la reproduction est donc l’affaire qui occupe toute leur vie. Les femelles ont seulement quelques jours pour rencontrer le bon partenaire, s’accoupler avec lui, puis trouver sa plante hôte et y déposer ses œufs.

Après la parade nuptiale, qui se réduit souvent à quelques acrobaties aériennes, l’accouplement a lieu dos à dos. En général, il est plutôt rapide, car les papillons sont très vulnérables dans cette position et ne peuvent faire face aux prédateurs . Mais il existe des exceptions comme chez les sésies du peuplier ou l’accouplement peut durer des heures. En cas de danger, il arrive d’ailleurs que les papillons s’envolent dans cette position. L’un des deux entraine alors l’autre à sa suite tout en restant soudé par les organes génitaux.
Lors de l’accouplement, le mâle introduit les spermatozoïdes dans l’appareil génital de la femelle soit directement soit par le biais d’un spermatophore .
Les œufs se développent dans l’abdomen de la femelle dès son émergence et sont fécondés juste avant la ponte.
De l’importance du climat sur la reproduction
Selon le climat, les papillons peuvent modifier le rythme de la reproduction . Le Tircis (pararge aegeria) par exemple, qui est présent du nord au sud de l’Europe , se développe sur deux générations annuelles au nord alors qu’il peut en faire 3 ou 4 plus au sud . Sur l’ile de madère où le climat est tropical, le Tircis enchaine même les générations tout au long année et ne connait plus aucune diapause.
Fidèle ?
Chez certaines espèces, les femelles n’ont de relations qu’avec un seul mâle et refusent les suivants alors que chez d’autres elles acceptent toutes les sollicitations et peuvent enchainer les accouplements avec plusieurs partenaires . Pour être sûrs de leur paternité, les mâles ont élaboré des stratégies qui consistent à occulter les voies génitales des femelles avec une sorte de sécrétion crémeuse qui sèche à l’air et bouche définitivement les parties génitales . L’Appolon est coutumier du fait et fabrique une sorte de gros bouchon qui est appelé le sphragis.

Domaine public
Protandrie
Dans un certain nombre d’espèces ,les mâles apparaissent quelques jours avant les femelles.
Ce phénomène a pour nom la protandrie.
Plusieurs hypothèses tentent de l’expliquer ;
Pour les uns, la raison de ce décalage viendrait de ce que les femelles sont fécondes très peu de temps et qu’il est bon que de nombreux mâles soient disponibles pour les féconder dès qu’elles émergent.
Si l’on croit le dictionnaire entomologique de l’opie, ce mécanisme a pour fonction d’éviter la consanguinité qui pourrait exister si frères et sœurs naissaient le même jour.
Une étude menée en suède* sur les populations de papillons citron avance, elle, une autre cause.
La protandrie aurait pour vocation de favoriser les accouplements et de donner un avantage aux mâles qui naissent en premier. Ceux-ci auraient plus de chance de tomber sur une femelle non fécondée et donc de transmettre leurs gènes. Certaines espèces, via la sélection naturelle, auraient inclus dans leur cycle ce décalage d’émergence .
Parmi les lépidoptères ,le papillon citron est connu pour être une espèce qui pratique le plus la protandrie.
La protandrie n’est pas l’exclusivité des animaux puisque de nombreuses plantes comme les astéracées ou les lamiacées la pratiquent aussi. Chez ces plantes, les pollens sont lâchés avant que le stigmate ne soit réceptif.
Patrouilleurs ou solitaires?
Les lépidoptéristes divisent le comportement des papillons mâles en deux groupes . Les patrouilleurs, qui sillonnent un territoire connu en faisant des aller-retour à la recherche des femelles, et les sentinelles, qui se postent en hauteur et attendent que les femelles passent devant eux .

Il est difficile de ne pas reconnaitre dans ces attitudes celles des mâles humains qui ont à peu de choses près les mêmes stratégies.
On pense bien sûr à ces hommes qui s’installent aux terrasses des cafés pour regarder passer les femmes ou à ceux qui écument les soirées en espérant ne pas revenir bredouilles .
Partant de là, on peut imaginer que les ressemblances existent aussi du côté des femelles et qu’il y a surement des lépidoptères femelles qui « papillonnent » en mettant en avant leurs atouts et d’autres qui utilisent un style plus direct qui ne laisse aucun doute quant à ce qu’elles désirent.
Générations
Ce que l’on nomme une « génération » est l’ensemble des individus d’une même espèce qui naissent au même moment dans un lieu donné.
Comme chacun peut le constater, les papillons en Europe ne sont pas présents en permanence. Absents en hiver, ils apparaissent au printemps lorsque les températures sont devenues plus clémentes. Chez les papillons, qui sont des insectes holométaboles*, la génération est le fruit d’un cycle de métamorphose qui commence par l’œuf ,se poursuit par le stade de la chenille puis celui de la chrysalide avant d’arriver à l’ultime métamorphose appelée le stade de l’imago. Ce dernier stade a été baptisé ainsi par le naturaliste suédois Carl von Linné, car l’insecte devenu un papillon adulte est enfin à l’image de ses parents.

Les premiers papillons que l’on voit arriver en premier fin février ou début mars sont les papillons qui ont passé l’hiver à l’état d’adulte. Pour traverser ce moment difficile, ils se sont protégés du froid en se cachant dans des granges, derrière des volets ou sous des tas de feuilles. Certains d’entre eux, comme le citron (Gonepteryx rhamni), produisent même du glycérol qu’ils s’injectent dans le corps et les ailes pour ne pas geler. Les premières générations arrivent un peu plus tard et sont le fruit des lépidoptères qui ont passé l’hiver au stade de la chrysalide , de la chenille ou de l’œuf . Les papillons peuvent en effet hiverner à tous les stades de leur métamorphose .
Selon les espèces et selon le climat il y avoir 1 2 , 3 voire 4 générations dans l’année .
Les espèces monovoltines
De nombreuses espèces sont monovoltines* , c’est-à-dire qu’elles ne produisent qu’une génération par an . Les œufs sont en général pondus en fin d’été ou au début de l’automne et les individus passent l’hiver au stade de l’œuf de la chenille ou de la chrysalide .


c’est le cas de l’aurore (Anthocharis cardamines) qui se sort de sa chrysalide au printemps et que l’on peut admirer dès le mois de mars avril . On peut la voir pendant un mois ou deux puis il faudra attendre l’année suivante pour admirer à nouveau la tache orange du mâle et le dessous blanc marbré de vert des deux sexes. C’est aussi le cas du demi-deuil ( Melanargia galathea ) que l’on peut apercevoir en France du mois de mai- juin au mois de septembre ou de l’hespérie de l’épiaire (Carcharodus lavatherae) qui vole entre mai et aout . L’aurore hiberne à l’état de chrysalide alors que le demi-deuil et l’hespérie de l’épiaire le font à l’état de chenille ce qui explique pourquoi l’aurore apparait plus tôt.
Les espèces bivoltines ou plurivoltines
Certaines espèces de papillons produisent plusieurs générations par an. Au printemps apparait la première génération qui a passé l’hiver en hibernation. Celle-ci se reproduit puis les générations se succèdent. La succession rapide des générations est rendue possible grâce à la douceur des températures et à l’abondance de nourriture qui favorise la reproduction et
Selon l’espèce et selon le climat, il peut y avoir deux ou trois générations avant l’arrivée de l’automne. Le machaon, la belle dame ou la piéride du navet peuvent produire de 1 à 4 génération par an selon l’endroit où ils vivent.



Dans le nord de la France, les papillons n’ont le temps de produire qu’une génération alors que la même espèce peut en produire deux , trois et parfois même quatre dans le sud.
Certaines espèces ont des particularités qui permettent de distinguer entre les générations printanières et les générations estivales. Un papillon comme la carte géographique a même un dimorphisme saisonnier très marqué avec sa forme de printemps F levana et sa forme d’été (f. prorsa) .
Le froid arrête le processus des générations, car les papillons sont des insectes ectothermes et qu’ils dépendent de la température extérieure, mais les trop fortes chaleurs peuvent aussi le stopper. Pour cette raison on ne voit pratiquement plus de papillons lors des grosses canicules Dans les deux cas, les papillons se mettent en diapause et attendent que les bonnes conditions reviennent. Sous nos latitudes, la durée de vie des papillons va de quelques jours pour certaines espèces à plus d’un an pour celles qui passent l’hiver en hibernation.


Ci dessus papillons de la fôret tropicale
La forêt tropicale est l’endroit sur la planète où l’on trouve le plus de papillons. C’est aussi le lieu où l’on rencontre les plus colorés . La raison vient de ce que le climat est celui qui leur convient le mieux et qu’il y a une richesse botanique incroyable. Les papillons ont à leur disposition de nombreuses plantes hôtes et n’ont qu’à se pencher pour trouver de la nourriture .
Une autre raison est la faible densité d’humains dont la forte présence est toujours la principale cause de disparition des espèces.
La chaleur et l’humidité y sont permanentes et permettent aux générations de s’enchainer tout au long de l’année.
En France, c’est la région méditerranéenne qui convient le mieux aux papillons . le climat tempéré du bord de mer est idéal pour eux et la durée du jour , plus importante qu’au nord, permet aux espèces de produire deux ou trois générations.
*Génération : l’ensemble des individus d’une même espèce qui naissent au même moment dans un lieu donné.
*Monovoltin : De « mono » seul et de « volvere » , se dérouler, évoluer .
Se dit des espèces qui ne produisent qu’une génération par an.
*Bivoltin : Des mots « bi » , deux et de « volvere » ,se dérouler, évoluer .
Se dit des espèces qui ont deux générations par an.
*Plurivoltin ou multivoltin :
De pluri ou multi , plusieurs et volvere, se dérouler, évoluer.
Se dit des espèces qui produisent plusieurs générations par an.
*Homolétabole
Terme qui qualifie les insectes dont le cycle évolutif passe par une métamorphose complète. (Œuf, larve, nymphe, imago) .le terme holométabole est opposé au mot hétérométabole).
Parmi les insectes holométaboles on trouve : les lépidoptères, les coléoptères, les hyménoptères, les diptères ,ect…
Le parasitoïsme
Il existe chez les animaux de nombreuses interactions interespèces qui vont du mutualisme au parasitisme . Le premier est un arrangement gagnant-gagnant entre deux espèces qui tirent toutes deux des bénéfices de la relation.

Entre le bœuf et le héron, par exemple, existe une relation où chacun trouve son compte. La vache fait sortir du sol des insectes que le héron peut attraper facilement et en retour le héron débarrasse la vache de ses parasites.
Le deuxième est moins sympathique puisque le bénéfice est unilatéral et qu’une seule espèce en tire du bénéfice alors que l’autre n’en retire que du désagrément. Le parasitisme est très désagréable pour l’hôte qui est exploité par un autre être vivant, mais il conduit rarement à la mort .
C’est ce qui le distingue du parasitoïsme qui est une interaction entre deux espèces où l’espèce parasitée meurt toujours à la fin. Les papillons sont très souvent victime de ce type d’interaction. Le deuxième et le troisième stade de la métamorphose qui correspondent aux chenilles et aux chrysalides sont particulièrement attaqués.
(Nymphes de guêpe ichneumon sur une chenille de sphinx du tabac . (photo Google ))

Le cas le plus connu de parasitoïsme est celui de la guêpe ichneumons. La femelle de cet hyménoptère pond ces œufs sur le corps ou directement dans le corps de la chenille grâce à son ovipositeur qui lui permet de percer la chair . Une fois éclot, la larve se nourrit de l’intérieur du corps de la chenille. En général, elle commence par les parties non mortelles pour garder la viande fraiche le plus longtemps possible puis s’attaque aux parties vitales . La chenille finit par mourir. La larve sort alors du corps de son hôte et se nymphose sur la dépouille ou juste à côté.
Le naturaliste britannique Charles Darwin avait été frappé par le parasitoïsme de la guêpe ichneumons . Il disait qu’il avait définitivement cessé de croire en Dieu après avoir découvert le processus de ponte de la guêpe Ichneumon .
Dans une lettre envoyée en 1860 au botaniste américain Asa Gray, il écrivait:
« Je ne parviens pas à voir aussi pleinement que d’autres ni aussi pleinement que je le souhaiterais, la preuve d’un dessein et d’un dessein généreux dans ce qui nous environne. Il me semble qu’il y a trop de misère en ce monde. Je n’arrive pas à me persuader qu’un Dieu bienveillant et tout-puissant ait pu créer délibérément les ichneumons avec l’intention de les faire se nourrir de l’intérieur du corps de chenilles vivantes.…»
Les chenilles peuvent également être parasitées par les mouches de la famille des tachinidaes. Les femelles de cette espèce pondent leurs œufs sur la plante hôte de la chenille. Une fois éclot la larve de la mouche fait comme celle de la larve de la guêpe. Elle se rapproche de la chenille puis pénètre dans son corps où elle commence immédiatement le festin. Il arrive fréquemment que plusieurs insectes parasitoïdes s’attaquent aux chenilles ou aux chrysalides . D’autres parasites vivent sur l’hôte et profitent de la décomposition du corps. C’est le cas des acariens qui sucent les jus qui sortent du corps .


Des recherches ont montré qu’une chrysalide sur deux serait parasitée ou tuée par des maladies. Les mêmes études montrent que sur les 500 œufs pondus par la femelle seuls 2 ou 3 arrivent à l’âge adulte et parviennent à se reproduire.
Ces pratiques nous paraissent barbares, mais elles sont pourtant très fréquentes dans le monde des insectes.
Certains scientifiques considèrent même qu’il y a un bénéfice indirect pour l’espèce hôte . Selon eux, les parasitoïdes réguleraient les populations de papillons qui sans eux seraient beaucoup trop nombreux . Dans certaines espèces, les femelles peuvent pondre jusqu’à 500 œufs. Les spécialistes estiment que si les naissances n’étaient pas régulées, les individus trop nombreux épuiseraient les ressources et finiraient par mourir de faim .
Comme il est toujours difficile de savoir si la poule était là avant l’œuf, on peut aussi imaginer que les femelles papillons pondent beaucoup d’œufs pour compenser les pertes causées par les parasitoïdes et qu’elles en pondraient beaucoup moins si ces derniers n’étaient pas là.
Les papillons et les fourmis
On sait que les fourmis pratiquent le mutualisme avec les pucerons ou des cochenilles dont elles apprécient beaucoup le miellat sucré. On sait moins que les fourmis pratiquent également le mutualisme avec certains lépidoptères.
Myrmécophilie
Qui a déjà vu un papillon tomber dans une fourmilière et se faire immédiatement dévorer par des centaines de fourmis sera étonné. Et pourtant, les fourmis pratiquent bien le mutualisme avec les certaines espèces de lycènes . Cette relation au sein de laquelle chaque espèce profite positivement de l’autre est appelée myrmécophilie lorsqu’elle se déroule entre des fourmis et une autre espèce. Ce peut être une autre espèce animale, mais aussi des espèces végétales . Un exemple connu que j’ai déjà évoqué ailleurs est celui qui unit les fourmis d’Amérique centrale Pseudomyrmex ferruginae avec des arbres du genre vachellia (ex acacia).
(Une

L’arbre fournit un abri aux fourmis et les nourrit grave à des petites excroissances qui fournissent un liquide riche en sucre et en protéines . En échange, les fourmis protègent l’arbre en attaquant violemment les ruminants qui auraient la mauvaise idée de vouloir croquer ses feuilles. Elles vont même jusqu’à désherber le pied de l’arbre pour qu’un autre végétal ne vienne pas faire de l’ombre à leur hôte.
Avec les lépidoptères le mutualisme se déroule au stade la chenille. Il existe principalement avec des membres de la famille des lycènides . Les chenilles de ces espèces sont en effet dotées de petits mamelons sécrétant un liquide sucré qui se rapproche du miellat et qui plait beaucoup aux fourmis. Pour les fourmis, ce liquide est un apport nutritif important qui est notamment très apprécié au début du printemps quand les pucerons ne sont pas encore apparus.
Le liquide des chenilles est tellement apprécié que plusieurs espèces de fourmis peuvent se battre pour en garder le contrôle. En echange du nectar les fourmis s’occupent de la chenille et lui assurent une protection contre les predateurs.
La glande de Newcomer
Les glandes qui fournissent le liquide sucré se nomment les glandes de Newcomer et portent le nom de l’entomologiste anglais Erval J.Newcomer qui les décrivit en 1912. Ces glandes ont la particularité de distribuer des gouttes d’un liquide sucré et riche en acide aminé lorsqu’elles sont stimulées par les antennes des fourmis . Le gout dépend de la plante hôte de la chenille ce qui explique pourquoi certaines chenilles sont plus sollicitées et apprécie par les fourmis .
Les relations que les chenilles entretiennent fourmis vont des relations occasionnelles à des relations obligatoires.
Les relations occasionnelles
Certaines espèces de chenilles ont des relations occasionnelles, dites facultatives, avec les fourmis. C’est alors l’occasion qui fait le larron. Les femelles papillons pondent leurs œufs sur les plantes hôtes qui se trouvent de préférence près d’une fourmilière. Attirés par l’odeur des chenilles, les fourmis ne tardent pas à venir les voir puis reste à proximité pour bénéficier de leur miellat. En échange elles les protègent des parasitoïdes ou d’autres prédateurs. Il arrive même qu’elle reste près d’elles la nuit pour les protéger, mais la relation n’est pas obligatoire. Ces chenilles apprécient la présence des fourmis et leur protection, mais peuvent parfaitement se développer si la femelle papillon s’est trompé et à pondu ses œufs loin d’une fourmilière .
(Fourmis crématogaster sp protège la chenille d’une chenille de lycaenidae (photo Google )
L’importance de ces chenilles pour les fourmis est telle qu’il arrive qu’elles récupèrent des chrysalides pour les protéger et les mettre à l’abri dans leur fourmilière. l’intérêt, là, est d’avoir la certitude que le papillon arrivera à son terme sans être parasité qu’il se reproduira et donnera vie à d’autres chenilles qui viendront les nourrir. Quand la nourriture est bonne, on a envie qu’elle revienne.
Les relations obligatoires
D’autres espèces de lycènes ne peuvent pas se passer de ce mutualisme et meurent si les fourmis ne s’en occupent pas. Comme dans le cas précédent, les femelles de ces espèces pondent alors leurs œufs en prenant soin de le faire sur des plantes hôtes qui se situent à proximité des fourmilières. Les chenilles sont alors visitées par les fourmis qui se nourrissent de leur miellat et les protègent . Il arrive aussi que ces chenilles entrent dans la fourmilière, mais sans jamais se nourrir des larves . La protection des fourmis est ici essentielle, car sans elles ces espèces seraient complètement parasitées et disparaitraient. Le lien qui unit les deux espèces est tel que la disparition de l’une, dans un espace donné, pourrait amener la disparition de l’autre.
Les relations obligatoires parasites
La myrmécophilie est une relation gagnant entre deux espèces qui en tirent profit . Quand l’un des deux en retire un bénéfice mais que l’autre y perd au change, on n’appelle plus cela le mutualisme ou la myrmécophilie mais le parasitisme.
C’est le cas, par exemple, entre l’azuré du serpolet (phengaris arion) et les fourmis.
Le cycle débute comme les autres par la ponte de la femelle qui choisit une plante hôte à proximité d’une fourmilière. La chenille commence son développement en se nourrissant de sa plante hôte et après plusieurs mues se laisse tomber au sol. Encore minuscule, elle gonfle légèrement son thorax pour ressembler aux larves des ouvrières et émet des signaux chimiques et acoustiques rapidement détectés par les fourmis. L’une d’entre elles vient alors la ramasser et croyant avoir affaire à une larve de fourmis la transporte dans la fourmilière. La chenille, qui se nourrissait jusque-là de feuilles, change alors son alimentation et se met à manger les larves des fourmis. Là s’arrête la myrmécophilie, et là commence le parasitisme.
Bizarrement, les fourmis la laissent faire bien que cette dernière soit en train de dévorer leurs petits . Il semblerait que la chenille émette des odeurs qui neutralisent l’agressivité des fourmis et qu’elle pousse des petits cris qui imitent les signaux de détresse des ouvrières. Ces deux actions font qu’elle devient inattaquable et qu’elle est même protégée par l’ensemble de la fourmilière.
La chenille vivra ainsi aux dépens des fourmis pendant une dizaine de mois avant de se transformer en chrysalide puis devenir un papillon adulte .
Les prédateurs
On parle souvent des dégâts causés par les chats sur les populations d’oiseaux. Bien plus rarement des dommages causés sur les oiseaux sur les populations de papillons. Je n’ai d’ailleurs jamais entendu une seule personne se plaindre des traitements infligés aux chenilles ou aux vers de terre par d’autres espèces, alors que la prédation du chat sur les oiseaux déchaine les passions et génère des tas de commentaires agressifs sur les réseaux sociaux.

Et pourtant la mésange ou les moineaux font autant de dégâts, voire bien plus, sur les populations de lépidoptères. Mais pas une seule plainte !
La raison ? Les humains s’identifient à la « gentille » petite mésange alors qu’ils ne veulent pas entendre parler de la « méchante » chenille ou du « vilain » ver de terre qui les dégoute.
Ils souhaitent donc défendre la mésange dans laquelle ils se sont projetés alors qu’ils se moquent de la vie du ver ou de la chenille qu’ils rejettent et dont ils ne veulent pas entendre parler.
Le narcissisme, là encore, est au cœur de la relation que les humains entretiennent avec les autres espèces. On n’aime pas l’animal pour ce qu’il est, mais on l’aime uniquement si on peut s’y projeter. Ce n’est pas lui qu’on aime, mais nous, en lui.
Les principaux prédateurs des chenilles et des papillons sont en effet les oiseaux. Les insectivores s’en nourrissent pendant toute la belle saison. Mais ils ne sont pas les seuls.

Les oiseaux granivores comme les moineaux en font une consommation très importante au moment de la nidification pour nourrir leurs petits qui ont besoin des protéines contenues dans le corps des chenilles et des vers pour se développer.
Un seul couple de mésanges bleues ou de mésanges charbonnières peuvent consommer jusqu’à 500 insectes par jour pour nourrir leurs petits. Étant donné le nombre de naissances des passereaux au printemps, on peut imaginer l’importance de la prédation qui se déroule à cette période.
Des observations ont aussi montré que de nombreux papillons portaient des traces de becs d’oiseaux. Ceux-là ont réussi à échapper aux prédateurs, mais on pouvait en déduire une fréquence d’attaques très importantes et considérer qu’un nombre tout aussi important de papillons n’ont pas eu cette chance. Des études plus larges ont montré qu’un papillon sur deux est tué par les oiseaux avant d’avoir eu le temps de se reproduire. Les moins chanceux sont tués avant même d’avoir été totalement libérés de leur chrysalide, mais la plupart sont surpris lorsqu’ils sont au repos ou en vol. L’habilité redoutable des oiseaux insectivores leur laisse peu de chance.



Pour se protéger des prédateurs, les chenilles et les papillons ont développé des stratégies qui fonctionnent plus ou moins. Parmi elles se trouve l’aposématisme qui prévient le prédateur d’un danger par des signaux, des sons ou des odeurs. D’autres stratégies existent comme se laisser tomber et faire semblant d’être mort. Cette stratégie est d’ailleurs employée par de nombreux insectes.
Ils utilisent également le camouflage en ayant un côté des ailes qui ressemble à l’environnement dans lequel ils se trouvent. Les ailes des lépidoptères comportent d’ailleurs souvent deux faces très différentes. Une qui sert à se cacher. En principe, le dessous. On parle alors de motifs cryptiques. Et une autre qui sert à faire peur aux prédateurs. C’est le plus souvent le dessus sur lequel on peut trouver des ocelles qui ressemblent à des yeux.

Les papillons sont également victime des guêpes comme je l’ai montré dans le chapitre précédent. Ils sont aussi la proie des mantes religieuses ou araignées qui les immobilise dans leurs toiles . Les plus gros parviennent souvent à s’en extraire, mais les plus petits parviennent rarement à s’en sortir .
Les petites araignées-crabes (misumena vatia) sont aussi de redoutables prédateurs des papillons. Perchées au somment d’un iris, d’une pivoine ou d’un viburnum, elles peuvent restés des heures immobiles sans bouger. Elles sont d’autant plus difficiles à voir qu’elles peuvent changer sa couleur en fonction de la fleur sur laquelle elles se trouvent.


Elles sont ainsi capables de passer en quelques jours de la couleur jaune à la couleur blanche pour se fondre dans le décor . Très patientes, elles attendent qu’un papillon vienne se poser devant elles. Elles se jettent alors sur lui, le maintiennent avec leurs pattes avant et lui injectent leur venin paralysant . Celui-ci contient des agents dissolvants qui réduisent les chairs en jus que les araignées aspirent .

Parmi les prédateurs importants, on compte aussi les coléoptères . Une étude consacrée aux piérides qui vivent en plein champ a montré que les membres de la famille des Carabidae et quelques autres invertébrés détruisaient à eux seuls plus de 50 pour cent des chenilles au stade de la première et de la deuxième mue (instars ).
Cette même étude a également montré que les oiseaux commençaient à s’intéresser aux chenilles lors du 3e instar* et qu’ils étaient à cette occasion responsable de la prédation de 50 pour cent des chenilles.
Cette 3e mue et les suivantes correspondent au moment où les passereaux doivent apporter des protéines à leurs juvéniles pour que ceux-ci puissent se développer correctement. Les chenilles qui contiennent plus de 50 % de protéine et les vers de terre dont le taux frôle les 70 % sont pour eux la nourriture idéale .
D’autres animaux peuvent aussi s’en prendre aux chenilles comme les lézards, les serpents ou les souris .
Des bactéries, des virus et même des champignons pathogènes sont aussi la cause de nombreux décès parmi les chenilles
Les ocelles
Les ocelles sont des motifs ronds que l’on rencontre très fréquemment sur les ailes des papillons . Ils peuvent se trouver sur ou sous les ailes et peuvent être gros ou plus petits .

Noirs ou très colorés, ils contiennent parfois en leur centre 1 ou plusieurs petits points qui semble marquer le centre de l’ocelle . On dit alors que les ocelles sont pupillés.
Les naturalistes se sont beaucoup interrogés sur la fonction de ces motifs et plusieurs hypothèses ont été avancées .
Les grands ocelles auraient avant tout pour mission de faire peur aux prédateurs .


Lorsque l’un d’eux s’approche, le papillon ouvre ou ferme les ailes selon l’endroit où elles se trouvent et les ocelles, qui ressemblent à de grands yeux, apparaissent alors brusquement. Certains spécialistes pensent que le prédateur s’enfuie parce qu’il est persuadé de faire face aux yeux d’un animal plus grand que lui . D’autres trouvent que la première hypothèse est trop anthropomorphique et que la peur est surtout crée par la soudaineté avec laquelle ces formes géométriques souvent très colorées lui sautent au nez .
Les petits ocelles auraient une autre fonction et seraient là pour servir de cible.
Placé volontairement sur des zones non vitales elle aurait pour fonction d’attirer l’attaque des oiseaux ou d’autres prédateurs vers ces parties peut importantes pour les détourner des zones vitales qui condamnerait le papillon .
Mieux vaut perdre un petit bout d’aile que d’être attaqué à la tête au thorax ou à l’abdomen .

Certains papillons comme la Thecla zebrée ont une association de ligne et d’ocelles qui crée un trompe-l’œil et donne l’impression que sa tête est à un endroit alors qu’elle est en réalité à l’autre bout . La fonction de ce genre de dessin est de tromper l’oiseau qui attend souvent que le papillon décolle pour l’attraper . ici il s’attend à le voir décoller dans une direction et le papillon part dans une autre.
Le Mimétisme
Le mimétisme est un autre moyen de défense très fréquent chez les êtres vivants. Son objectif est toujours de faire croire que l’on est autre chose que ce que l’on prétend être. En règle générale, il a une fonction de protection . L’imitation est là pour tromper l’autre. Chez les papillons et de nombreux insectes, le mimétisme a principalement pour rôle de faire croire que l’on est toxique ou dangereux et que s’en prendre à nous serait une très mauvaise idée. Ce phénomène est notamment très fréquent chez les papillons tropicaux, mais on le rencontre aussi en Europe chez de nombreux insectes . Le « copieur » est toujours une espèce non toxique ou non venimeuse qui endosse la livrée colorée (aposématique*) d’un insecte toxique ou venimeux.
Chez les insectes la copie ne se fait pas bien sûr grâce à une volonté de l’animal, mais par le phénomène de la sélection naturelle découverte et décrite par Charles Darwin . Les animaux qui ont certaines qualités ou certaines particularités sont moins victimes des prédateurs et transmettent leur patrimoine génétique aux générations suivantes . À l’inverse, ceux dont les qualités et les caractéristiques sont moins adaptées au lieu où à l’environnement meurent plus facilement et transmettent moins leur patrimoine génétique. Ce n’est pas l’individu qui agit, mais l’environnement qui dicte sa loi .
Sur une certaine durée la forme particulière d’une espèce peut disparaitre et une autre se développer.
On distingue deux sortes principales de mimétisme. Le mimétisme Batésien et le mimétisme Müllerien.
Mimétisme Batésien
Ce mimétisme a été découvert par 1863 par l’entomologiste Henry Walter Bates. Au cours d’un de ces voyages en Amazonie il découvrit qu’un papillon avait évolué au fil du temps grâce au phénomène de la sélection naturelle pour prendre les couleurs d’un autre papillon qui faisait partie d’une autre famille. Bates compris que le premier papillon avait évolué pour profiter de la protection aposématique* du deuxième.
En faisant des recherches Bates trouva de nombreux autres cas de ce genre de mimétisme chez les reptiles (couleuvre faux corail) les papillons (sésie apiforme) , les syrphes ou les mouches (bombylidés) et il en tira quelque lois comme:


-L’espèce qui copie l’autre vit dans la même région et à la même période que l’autre
-Ceux qui copie sont toujours plus vulnérable que l’espèce copié. Ils sont également moins nombreux .
-Les copieurs font également toujours parti d’une famille différente du copié, etc…
La découverte de Henry Walter Bates prit alors son nom et on parle encore aujourd’hui de mimétisme Batésien pour nommer ce phénomène.
Le mimétisme Batésien est une stratégie d’adaptation par l’imitation.
Il s’agit de profiter de la crainte que génère « le vêtement » de l’autre pour se protéger et allonger sa durée de vie.
Elle implique toujours trois acteurs.
- Le modèle qui va être copié (sa tenue colorée signale sa toxicité)
- L’imitateur qui subit la transformation (il n’est pas toxique)
- Et le dupe qui va prendre l’imitateur pour le modèle (il prend l’habit pour le moine ).
Chez la plupart des animaux, cette stratégie met plusieurs milliers d’années à se développer puisque la sélection naturelle a besoin de temps pour faire évoluer génétiquement l’apparence d’une espèce . On comprend que la transformation importante de la Sésie du peuplier ne s’est pas faite en un jour. Il existe toutefois des exceptions comme la phalène du bouleau (Biston betularia) ou la transformation pigmentaire assez simple de la couleur blanche à la forme mélanique puis retour à la forme blanche se fit une période de 100 ans. Dans ce cas Il s’agissait moins de faire peur que de rester invisible sur le tronc des bouleaux (Voir article sur la phalène du bouleau )
Le mimétisme Batésien est une sorte de parasitisme
Le mimétisme Batésien est une sorte de parasitisme puisque l’imitateur copie le modèle et vit en quelque sorte « sur son dos ».
Et comme tout parasitisme il peut avoir des conséquences positives ou négatives.
Parmi ses conséquences inattendues, il y a le fait que l’espèce copieuse va dans un premier temps se développer, car elle est maintenant crainte des prédateurs et peu chassée. Sa population va alors croitre. Devant le surnombre quelques insectes « malvoyants » vont s’attaquer à elle se rendre compte qu’elle est excellente.
Le message va alors se répandre parmi les prédateurs que les insectes ayant cette tenue sont comestibles et l’effet aposématique va peu à peu disparaitre.
Le résultat de ce jeu de dupe est que le modèle lui-même, malgré sa réelle toxicité, va être attaqué et sa population mise en danger à cause de ces insectes imitateurs qui ont endossé son vêtement pour tromper les prédateurs.
La morale de cette histoire, si on peut en tirer une, est que toute action ou inaction peut avoir des conséquences et que la fragilité ou la force, les gentils ou les méchants ne sont pas toujours du côté qu’on croit.
On peut également se servir de ce type de phénomène très fréquent pour réaliser que la vie est faite de nombreuses illusions et que les êtres illusionnés qui prennent l’habit pour le moine sont bien plus nombreux qu’on l’imagine.
Mimétisme Müllerien
On parle de mimétisme Müllerien lorsqu’une espèce toxique imite une autre espèce toxique pour que l’impact visuel qui dit « DANGER » prenne encore plus de poids . À la différence du mimétisme Batésien, il n’y a pas ici de tromperie et encore moins de dupes puisque les deux espèces sont toxiques. Le mimétisme Müllérien est un mimétisme gagnant-gagnant. Le résultat est un renforcement du message qui protège encore mieux le copieur comme le modèle.
Le concept de mimétisme Müllérien doit son nom à Fritz Müller (1822/1897), un zoologue allemand qui l’a découvert et expliqué en 1878. Fervent défenseur de la théorie de l’évolution, il correspondait régulièrement avec Darwin qui disait de lui qu’ il était le roi des observateurs.
Mimétisme adaptatif
Il s’agit d’un mimétisme qui permet à l’animal de s’adapter à un événement particulier . La mutation de la phalène du bouleau est un exemple de mimétisme adaptatif .
Voir mon article sur la phalène
Conclusion
Ce que l’on peut retenir de cette histoire est que la nature est merveilleuse et que les espèces, contrairement à ce que l’on pourrait croire sur une courte durée, ne sont pas fixes, mais qu’elles ont au contraire une grande variabilité qui leur permet de s’adapter à de nombreux environnements.
Il ne faut jamais oublier que les formes qui sont considérées comme la norme aujourd’hui peuvent être considérées comme anormales demain, et que celles qui sont considérées comme à la marge aujourd’hui peuvent devenir la norme demain si leur particularité correspond à l’environnement à venir .
Il ne faut pas oublier non plus que l’évolution ne vient jamais des individus eux-mêmes, mais de l’environnement qui sélectionne ceux qu’il juge les mieux adaptés à la situation en piochant dans les individus qui se trouvent à la marge .
L’évolution est d’ailleurs un terme qui ne convient pas toujours puisque comme on l’a vu dans le cas de la phalène du bouleau une espèce peut évoluer pour s’adapter à un évènement particulier puis revenir à sa forme première lorsque cet évènement disparait .
Cryptisme
Du grec cryptos , « caché ».
Le cryptisme est un moyen de défense utilisé par les papillons pour se protéger des prédateurs comme les oiseaux ou les libellules . Il consiste en une coloration discrète du dessous des ailes qui fait que le papillon est peu visible lorsqu’il se pose sur une feuille ou une branche. Les couleurs utilisées sont en général ternes et proches des teintes de la nature. On trouve notamment des coloris verts , bruns, marron ou beige . Le dessous de l’aile peut même contenir toutes ses couleurs pour que le papillon puisse se fondre aussi bien sur un feuillage que sur un tas de terre .


Quand la couleur d’une partie de l’animal est de la même couleur que celle de son environnement, on parle de teintes homochromes. La couleur est importante, mais certaines espèces y ajoutent la forme.
Le Robert le diable (Polygonia c album) par exemple a des ailes de couleur brune qui peuvent faire penser à des feuilles mortes, mais il possède aussi des ailes aux contours très découpés dans lesquelles certains ont pu voir la tête d’un diable. Ces formes complexes ont pour but de tromper le prédateur en dissimulant la forme arrondie classique que les oiseaux connaissent bien et par laquelle ils sont attirés .
D’autres papillons , comme le citron , ont des ailes qui imitent la forme des feuilles.

Dans ce style, les exemples les plus frappants sont les papillons du genre Kallima appelés aussi “papillon-feuille”. Au repos, ces papillons sont quasiment indétectables tant ils ressemblent à un végétal. La couleur est exactement la même que celle d’une feuille morte, et le mimétisme va jusqu’à représenter les nervures.
Ce papillon pousse très loin le sens de la copie puisqu’il va même jusqu’à se laisser tomber comme une feuille morte lorsqu’il il se sent menacé.


Cette espèce est d’autant plus surprenante que l’intérieur de ses ailes est fortement coloré. La différence est telle entre les deux faces qu’on pourrait croire qu’il s’agit de deux papillons . La nature, ici, a voulu marquer le coup et elle a attribué à chaque face deux fonctions opposées . Le dessous est là pour cacher le papillon aux yeux des prédateurs alors que l’intérieur est là pour être vu de loin par les femelles et impressionner les concurrents .

Imite une fiente d’oiseau
Les papillons invisibles
Le cryptisme peut aller très loin. Certains papillons peuvent imiter des morceaux de bois, voire des fientes d’oiseaux. Certains papillons utilisent même la transparence comme moyen de défense. Pas vu pas pris. Mais cette stratégie est assez rare car elle comporte aussi des inconvénients. Les ailes transparentes ont en effet le défaut de briller au soleil et peuvent attirer les prédateurs. Pour cette raison les papillons transparents se rencontrent surtout dans les forêts tropicales épaisses ou l’atmosphère est plutôt sombre.
La transparence des ailes de ce papillon a été étudiée par des chercheurs allemands de l’institut de technologie de Karlsruhe qui ont mis en avant les grandes qualités de ces ailes . Les verres que nous fabriquons reflètent 8 à 100 % de la lumière en fonction de l’angle avec lequel ils sont touchés par le soleil. Les ailes du Greta oto, elles, ne reflètent que 2 à 5% de la lumière, et cela quel que soit le degré d’incidence de la lumière.
Après les avoir étudiés, les chercheurs ont découvert que ce phénomène très puissant d’absorption de la lumière venait de ce que les ailes étaient composées de nanostructures en forme de piliers dont chacune avait des tailles et des formes très différentes des autres.
Il semblerait que des recherches plus poussées aient lieu actuellement pour adapter ces qualités antireflets très puissantes aux verres de nos lunettes.
Lorsque le camouflage joue uniquement sur la couleur on parle de mimétisme homochromique
Lorsque le camouflage jour uniquement sur la forme on parle de mimétisme homomorphique.
Lorsque le camouflage joue sur la forme et la couleur on parle de mimétisme Homotypique.
D’où viennent les couleurs
Sur ce sujet pourtant passionnant, je ne m’étendrai pas, car il dépasse mes compétences et se situe dans un domaine qui reste très abstrait pour moi .

Pour ne pas vous laisser sans réponse, je reprends quelques éléments extraits de mes nombreuses lectures sur ce thème . Quand on veut comprendre, on ne compte pas .
la couleur des papillons peut provenir de 3 sources principales.
Elle peut être générée par des pigments, provenir d’une structure ou naitre grâce à la combinaison des deux facteurs.
Elle peut ainsi se trouver à deux endroits . Soit être contenue dans les écailles qui sont posées sur la structure due, papillon soit se trouver dans l’épiderme qui se trouve sous les écailles de telle sorte qu’elle ne disparait pas quand une écaille tombe comme cela arrive assez souvent . Elle peut aussi se situer dans un jeu entre plusieurs facteurs.
La coloration par pigments.
Les couleurs de type pigments sont d’origine chimique. Selon Paul Smart qui a écrit un article complet sur le sujet dans son encyclopédie des papillons, elles résulteraient de processus complexe comme l’excrétion.
Parmi les pigments dont disposent les papillons, on trouve : la mélanine responsable des couleurs noires et brunes . La ptérine qui crée le jaune ou le beige . La leucoptèrine pour le blanc. Mais il y a aussi la xanthoptérine (jaune), l’erythroptérine (rouge), etc.
La juxtaposition des écailles peut aussi donner l’impression de nouvelles couleurs.
Les pigments étant fragiles ils s’atténuent avec le temps et sont parfois presque effacés par l’action du soleil ou de la pluie qui les délavent .
La coloration structurelle
La coloration structurelle ou physique résulte, elle, de phénomènes optiques dus à de multiples causes comme la réfraction, la diffraction ou la polarisation de la lumière . On peut comparer le phénomène aux effets de couleur qui se produisent lorsqu’on observe une goutte d’huile tombée à la surface de l’eau . Eau comme huile sont des liquides totalement transparents et pourtant de nombreuses couleurs apparaissent . Il s’agit en réalité d’effets produits par la lumière qui traverse l’huile puis se réfléchit dans l’eau . La particularité de ce type de coloration est que la couleur se modifie selon le point de vue d’où on observe la scène .


La même chose se produit sur certains papillons qui peuvent paraitre marron lorsqu’on les regarde d’un certain angle et bleu quand on les observe d’un autre endroit ; ce phénomène que l’on retrouve sur d’autres animaux se nomme l’iridescence.
La coloration par pigments+ colorations structurelles .
Chez de nombreux papillons, on retrouve les deux sources de couleurs mélangées . le marron pigmentaire d’un papillon peut par exemple être balayé par l’iridescence bleue d’une couleur structurelle.
st en réalité à l’autre bout . La fonction de ce genre de dessin est de tromper l’oiseau qui attend souvent que le papillon décolle pour l’attraper . ici il s’attend à le voir décoller dans une direction et le papillon part dans une autre.
Les papillons et leurs plantes hôtes
Le printemps n’est plus très loin et c’est le bon moment pour installer quelques « plantes hôtes » pour nos amis les papillons.
Ce que l’on appelle « plante hôte » est un végétal sur lequel la femelle papillon va venir pondre pour que ces chenilles, à peine écloses, puissent se nourrir sans avoir à faire des kilomètres.

Chaque espèce a une ou plusieurs plantes hôtes et si vous plantez l’une d’elles dans votre jardin ou sur votre balcon il y a de grandes chances pour que le papillon viennent y déposer ses œufs . Inutile de dire que ces derniers vivent ensuite autour du lieu de ponte (la maternité) et qu’il y a de fortes probabilités pour qu’ils restent chez vous s’ils y sont nés.*
La plupart des lépidoptères sont en effet sédentaires même si certains d’entre eux effectuent des migrations. Le monarque américain ou notre belle dame européenne sont connus pour effectuer de longues migrations qui peuvent aller jusqu’à 4000 ou 5000 kilomètres aller-retour . La migration s’effectue bien sûr sur plusieurs générations .
On pense parfois à mettre des plantes nourricières pour que les papillons viennent les butiner, bien plus rarement à installer des plantes hôtes.
C’est aussi cela un jardin antispéciste. On ne le conçoit plus uniquement autour de soi, mais on le tourne vers d’autres espèces et on essaye de faire en sorte qu’elles s’y sentent bien.
Pour commencer, on laissera pousser l’ortie (Urtica dioca) qui est souvent considérée comme une mauvaise herbe par les adeptes du jardin bourgeois alors qu’elle est la reine des végétaux et la plante hôte qui attire le plus de papillons . Je l’apprécie tellement que j’ai créé une allée des orties au jardin des oiseaux. Mais je suis sûr que vous la verrez autrement dès que vous saurez que 40 papillons parmi les plus beau y pondent dessus . Laisser s’installer quelques plants d’orties dans son jardin c’est avoir la quasi-certitude de revoir des lépidoptères que l’on croyait disparus .

N’oubliez pas non plus que les fleurs naturelles « dites sauvages » sont les préférées des papillons (et des insectes) tant pour le butinage que pour la ponte. Une partie du jardin des oiseaux est laissé à l’état naturel et c’est elle qui, de très loin, voit passer le plus de papillons et d’insectes variés.
liste des plantes hôtes avec le nom des papillons qui viennent y pondre.
Plantes hôtes
Alliaire officinale : Piéride du navet
Achillée millefeuille : Mélitée orangée
Aristoloche : La Diane
Bouleau verruqueux : Morio, Feuille morte, Phalène perlée, Thécla du Bouleau,etc…
Bourdaine : Citron
Brachypode des bois: Sylvaine
Brachypode penné : Demi deuil, Sylvaine, Tircis, Hesperie du dactyle, Satyre
Brome dressé : Demi-deuil
Buis : Pyrale du buis
Camérisier : Petit mars changeant
Cardamine des près : Aurore
Centaurée jacée : Mélitée des centaurées , Mélitée du plantain , Phalène picotée, Ecaille pourpée, etc…
Chênes : Thécla du chêne
Chèvrefeuille : Sphinx gazé, sylvain azuré, petit sylvain, etc
Chou potager : piéride du chou
Colza : piéride de la rave, Piéride du chou, etc…
Cornouiller sanguin : Thécla de la ronce, Azuré des nerpruns
Coronille bigarré : Fluoré, Zygène de la coronille, Azur bleu nacré, etc…
Fenouil : Machaon, etc…
Fétuque rouge : Demi deuil
Framboisiers : Bombyx de la Ronce, Robert-le-diable, Ecaille chinée
Fuschia : Grand sphinx de la vigne
Gaillet blanc : Moro sphinx, Petit sphinx de la vigne, etc…
Groseillier épineux : Gamma, Vanesse des chardons
Hêtre commun: Zeuzère du poirier, Grand paon de nuit, Géomètre papillonaire
Houblon : Paon du jour
Houque laineuse : le némusien
Laurier rose : Sphinx du laurier rose
Moutarde des champs : Piéride du chou
Nerprun: Citron , citron de provence, la farineuse, l’azuré des nerpruns, la thécle de la ronce, la feuille morte du chêne, la phalène du marronier, etc….
Noisetier : Robert le diable
Orpins blanc : L’Appolon
Orties : Belle dame, Paon du jour , Petite tortue, Pyrale de l’ortie , L’Ecaille rouge , l’Ecaille martre, l’Ecaille cramoisie, l’Ecaille lièvre, l’Ecaille ensanglantée, la Carte géographique, le Vulcain, le Robert, le diable, Lambda, la Pulsie confluente, La Méticuleuse, la Noctuelle à lunettes,etc….
Oseille sauvage : Cuivré commun
Panais cultivé : Machaon
Pariétaire des muraills : Vulcain
Pâturins : Myrtil, Demi deuil, etc…
Pêcher : Flambé
Peuplier tremble : petit mars changeant
Primevères : lucine
Prunellier : Flambé, Gazé, Thécla du Prunellier, Phalène du Sureau
Prunier : Thécla du bouleau, flambé
Ravenelle : piéride de la rave
Rosacées : Gazé
Romarin : Azuré de la luzerne
Saule Marsault : Grand Mars changeant, Sésie frelon, Grande Tortue, , etc…
Trèfle : Argus bleu
Vigne : Grand sphinx de la vigne
Etc….
Comment les papillons passent t’ils l’hiver?
Comme on l’a vu dans des chapitres précédents, certains papillons choisissent de migrer. l’automne venu, ils repartent vers des climats plus adaptés à leur nature d’animaux ectothermes.
Mais nombre d’entre eux restent sur place et vont passer l’hiver à différents stades .
Le papillon est en effet un insecte holométabole*. C’est-à-dire qu’au cours de sa vie il va passer par plusieurs états avant d’atteindre son stade définitif de papillon que l’on appelle l’imago.

Les différents stades du papillon sont donc : l’œuf ; la larve (chenille), la nymphe (chrysalide) et le papillon (l’imago).
Selon les espèces, les papillons vont passer l’hiver dans l’un ou l’autre de ces stades .
1 l’œuf : De tous les stades, c’est surement le mieux adapté pour passer l’hiver . À l’abri de morceau de bois ou protégés par des broussailles, il peut faire face à de grands froids . Selon certaines études, les œufs seraient capables de survivre à des températures inférieures à 30 degrés . Autre avantage : étant de petites tailles, ils sont peu visibles des prédateurs .
2 La chenille : Les papillons hivernent souvent à l’état de chenille . Pour résister au froid, elles vont en général s’enterrer dans le sol non loin de leur plante nourricière ou fabriquer un cocon fait de soie de feuilles.
3 La chrysalide
D’autres papillons hivernent au stade de la chrysalide . Celle-ci est généralement enfouie dans le sol ou comme les chenilles, protégées par un cocon de soie. Pour permettre à l’insecte de supporter les grands froids, les tissus de la chrysalide contiennent des substances antigels à base de glycol. Une chrysalide peut ainsi résister à des températures de –25 degrés . il va sans dire que les hivers où le froid est intense sur de très longues périodes des dégâts très importants sur tous les insectes ectothermes qui se sont cachés essayer de survivre.

4 Le papillon
On ne l’imagine pas, mais beaucoup de papillons passent également l’hiver au stade de l’imago qui est le stade définitif de papillon . Les papillons vont d’abord chercher des abris comme les granges, les greniers, les cabanes de jardins, les petites cavités ou même des trous dans les murs. Mais tous ne parviennent pas à trouver d’abris qui les protègent complètement . Certains fabriquent donc des antigels à base de glycérol . Les substances sont sécrétées par les papillons à partir de l’automne et injectées à travers le corps et les ailes pour empêcher que les organes et les membranes ne gèlent . Ils vont ensuite se mettre à l’abri et se plonger dans un état de sommeil qui va ralentir tout le métabolisme.
Le citron (Gonepteryx rhamni) est l’un des papillons qui passent l’hiver à l’état de papillon ou comme le disent les spécialistes à l’état « d’imago ». Les citrons que vous voyez dès le mois de mars sont des papillons qui viennent de sortir de l’état de diapause dans lequel il s’était placé à l’automne. L’unique génération du citron apparaitra au jardin vers le mois de juin ou juillet. Le citron fait partie des papillons qui vivent longtemps puisque sa durée de vie est de 12 mois.

D’autres papillons passent l’hiver à l’état d’imago comme la petite tortue qui est une championne dans sa catégorie puisqu’elle est capable de survivre à des températures de – 24 degrés .
Et les fortes chaleurs comment les supportent t’ils ?
Les papillons étant des animaux ectothermes, ils ne supportent pas le froid, mais ne supportent pas mieux les très fortes chaleurs.
S’il fait trop chaud, leur température corporelle augmente et ils se déshydratent rapidement . Pour lutter contre ces chaleurs, ils doivent s’abriter du soleil et trouver des coins d’ombres . Ils vont également chercher à boire en buvant dans des flaques, des piscines ou sur le bord des rivières.
Vous avez peut-être remarqué que lors des journées d’été extrêmement chaudes on voit beaucoup moins de papillons. La raison est qu’ils se protègent du soleil et qu’ils ressortiront en début de soirée . S’ils se trouvent dans des régions pour des pays où la température monte subitement au-delà de ce que les papillons sont capables de supporter, ils vont alors se mettre dans un abri et entrée en diapause comme ils le fond à la fin de l’automne. Cet état leur permet de ralentir leur métabolisme et de pouvoir supporter les très fortes chaleurs. D’autres reprendront la route et migreront vers des régions où ils trouveront les températures adaptées à leurs organismes . C’est ce que font d’ailleurs les très nombreux papillons d’Afrique du Nord qui entreprennent une grande migration au début du printemps pour venir s’installer en France et jusqu’au nord de l’Europe où les températures seront bien moins chaude qu’en Afrique. la température idéale pour la plupart des papillons se situe entre 22 degrés et 28 degrés .
Combien de temps vivent les papillons?
La durée de vie des lépidoptères est très variable selon les espèces et peut aller de quelques heures à plusieurs mois, voire plusieurs années si l’on tient compte de tous les stades .
Les papillons éphémères
Certains papillons de nuit comme le petit paon de nuit ou le bombyx des buissons ne vivent à l’état adulte que quelques heures ou quelques jours . À peine le temps de trouver un partenaire, de s’accoupler puis de pondre pour la femelle .

Le petit paon de nuit mâle, par exemple, meurt après deux ou trois jours après avoir émergé de sa chrysalide alors que la femelle vit un peu plus longtemps (une semaine) pour avoir le temps de pondre ses œufs.
Dépourvus de trompe, ces papillons ne peuvent pas s’alimenter. Leur vie est exclusivement consacrée à la perpétuation de l’espèce. Les mâles de cette espèce possèdent heureusement des d’antennes pectinées très performantes qui leur permet de détecter rapidement les phéromones diffusées par les femelles.
Les membres de la famille des Psychidae possèdent eux aussi des pièces buccales atrophiées qui ne leur permettent pas de se nourrir . Les mâles sortent de leur pupe après la nymphose et s’envolent aussitôt à la recherche des femelles. Ces dernières ne sortent pas toujours de leur fourreau.

Quelques-unes s’en libèrent le temps de l’accouplement, mais d’autres sont fécondés par les mâles à même le fourreau et elles y effectuent la ponte juste avant de mourir. Ces papillons vivent entre 1 et 5 jours à l’état adulte .
Mais tous les papillons ne sont pas aussi éphémères.
Les papillons qui vivent plus longtemps
Les papillons qui ont une trompe ( probiscis) et qui sont capables de se nourrir vivent en général plus longtemps .
Les champions de la durée sont ceux qui hivernent à l’état adulte ou qui effectuent des migrations .
En France, le citron , le Robert, le diable, le vulcain, la grande tortue ou le paon du jour qui hibernent à l’état adulte peuvent vivre pendant 10 mois. Les générations qui émergent des chrysalides en juillet-aout passent l’hiver à l’abri . Au printemps, ils sortent de la diapause et se remettent à voler jusqu’au mois d’avril ou mai de l’année suivante .



À l’étranger, le monarque peut vivre 9 mois à l’état adulte.
Mais la vie d’un papillon ne se résume pas à son stade adulte.
Si l’on prend en compte les 3 autres stades de la métamorphose des lépidoptères, ce sont les espèces xylophages comme les membres de la famille des Cossidae ou des Sessidae qui vivent le plus longtemps puisqu’ils peuvent passer entre deux et 4 ans au stade larvaire.

Un papillon de nuit comme le grand paon de nuit peut rester 1 ,2 ou 3 ans immobile sans manger enfermé dans leurs chrysalides.
Certains papillons qui vivent en altitude ou dans des pays plus froids peuvent également vivre plusieurs années (2 ou 3 ans) au stade nymphal .
La disparition des papillons
Ces dernières années, plusieurs études ont montré la disparition rapide des insectes. Une étude est particulièrement significative puisqu’elle montre que les populations d’insectes ont diminué de 75 à 80 pour cent ces trente dernières années dans les pays européens .

Ces chiffres, très parlant, ne sont hélas pas pris au sérieux par l’opinion publique et encore moins par les autorités qui considèrent bien souvent les insectes comme quantité négligeable. On veut bien faire quelque chose pour l’abeille domestique qui produit du miel et nous rapporte de l’argent, mais on ne va pas stopper notre si belle agriculture intensive pour quelques malheureuses chenilles et autres araignées qui ne provoquent bien souvent chez les humains qu’une moue de dégout.
Un déclin général
Les scientifiques et les entomologistes nous alertent pourtant régulièrement sur le déclin très rapide des insectes qui sont particulièrement sensibles aux polluants.
Le dernier rapport de L’IPSES (Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques) montre que la disparition très rapide des insectes fait partie d’un déclin général. Selon ce même organisme, plus d’un million d’espèces pourraient disparaitre à brève échéance si les humains continuent à se comporter comme il le font aujourd’hui.
Les humains seuls responsables
Car nous sommes bien la seule cause de cette catastrophe écologique sans précédent . Selon certains elle serait même la plus grande crise d’extinction des espèces qu’ait jamais connu la planète.
la culture intensive qui a débuté au début du siècle et qui n’a cessé de se développer depuis est la première responsable.
Les insectes ont commencé à disparaitre dès le début de ce type d’agriculture qui utilise énormément de produits chimiques . L’utilisation des intrants comme les insecticides, les fongicides ou les herbicides sont autant de poisons qui tuent en masse les insectes. D’après la Commission européenne (Eurostat) 1,15 kilo de pesticides aurait été pulvérisé par hectare en France .

Une autre cause est la destruction des habitats. Sous la pression de l’agriculture et des constructions humaines, de plus en plus d’espaces qui étaient autrefois habités par les insectes sont bétonnés ou transformés et deviennent invivables pour les bourdons , les papillons ou les diptères qui n’y trouvent plus ni abri ni nourriture . Les monocultures à perte de vue sont une véritable catastrophe pour la biodiversité comme l’est la destruction massive des espaces naturels pour y construire des immeubles ou des lotissements .
Parmi les autres causes, on peut citer l’assèchement progressif des zones humides, le développement exponentiel du tourisme de masse ou encore l’éclairage permanent des villes et des campagnes qui perturbent considérablement l’activité des papillons de nuit . Rendus comme fous par les lumières, ces papillons passent leur nuit à se heurter contre les lampadaires . On les retrouve au petit matin vidés de toute leur énergie et si fatigués qu’ils en oublient de se nourrir ou de se reproduire . Dans son livre « Quel est ce papillon ?», Heiko Bellman décrit des femelles tellement perturbées par les lumières qu’elles ne sont plus capables au petit matin de trouver leurs plantes hôtes et déposent leurs œufs sur le premier support venu où les chenilles n’auront aucune chance de trouver leur nourriture.
La désertification des campagnes
Paradoxalement, une autre raison de la disparition des papillons est la désertification de certaines campagnes reculées au profit de certaines zones surexploitées . Des surfaces importantes autrefois consacrées à la pâture sont aujourd’hui abandonnées et se transforment petit à petit en forêts qui sont moins favorables aux papillons que les prairies remplies de fleurs extrêmes variées . Mais cela n’est pas un problème puisque cela ne concerne ici que les papillons et que d’autres insectes peuvent se développer et vivre dans des milieux boisés. Il vaut mieux après tout une forêt remplie d’insectes variés avec peu de papillons, qu’une ville entièrement bétonnée où aucune espèce ne peut se développer.
Le changement climatique
Une autre cause produite par les humains est le réchauffement climatique. Celui-ci crée des phénomènes météorologiques extrêmes comme les inondations ou les canicules qui provoquent des feux de forêt très importants . On parle souvent des dégâts causés par le feu sur les habitations, mais l’on parle rarement de l’impact terrible que ces incendies ont sur les insectes (et les autres animaux) qui sont purement et simplement rayés de la carte.
Je me souviens à ce sujet d’un fait divers qui m’avait choqué et qui montre le peu d’intérêt que notre société porte aux autres animaux.
Il y a quelques années ,une animalerie du Mans avait pris feu et le bâtiment avait été entièrement détruit .
À la télévision, une journaliste avait expliqué que 157 animaux de compagnie et 4 000 poissons avaient péri, brulés dans les flammes. Parmi eux ,des rongeurs, des poules, des reptiles, des oiseaux, des poissons, etc.
-“Heureusement, avait-elle ajouté, personne n’a été blessé.”
Les papillons
La population des papillons d’Europe est particulièrement suivie par les scientifiques, car ils sont très sensibles à la pollution et à la destruction quasi industrielle des habitats dont ils dépendent. Certains papillons ne pondent que sur 1 ou 2 plantes hôtes. Il suffit que ces plantes disparaissent d’une zone pour que l’espèce disparaisse avec elles . On comprend alors pourquoi les monocultures sont une plaie et une véritable insulte faite à la biodiversité. Et cela est aussi vrai pour les champs de blé à perte de vue que pour les régions viticoles où le terroir est terriblement appauvri par la surreprésentation d’une seule espèce végétale.

En Allemagne, par exemple, où de nombreuses études ont été faites, plus de 40 pour cent des espèces de papillons sont menacés d’extinction et un certain nombre sont déjà éteintes . Plus de 67 espèces de papillons vivaient il y a 100 ans autour de Düsseldorf alors qu’on n’en compte plus que 27 aujourd’hui. Sur les 480 espèces qui vivent aujourd’hui en Europe, 10 pour cent sont menacées et les populations de 30 % d’entre elles sont en déclin prononcé .
Dans leur livre « il faut sauver les insectes » Pierre-Olivier Macquart et Denis Richard cite des chiffres qui devraient nous faire réfléchir :
En France le Mélibée (fadet de l’élyme) a disparu de 88 % des départements où il était présent en 1980 et il est considéré en danger critique.
L’Hermite (Chazara briseis) a disparu de 72 % des départements où il volait.
La bacchante a disparu de 48 % des départements où elle volait , etc…
D’autres auteurs* note la régression du fluoré (Colias alfacariensis), de l’Azuré bleu céleste (Lysandra bellargus) ou de l’Azuré bleu nacré (Lysandra coridon). Il n’existe pas en France de suivi précis des papillons de nuit, mais il y a de fortes probabilités pour que leurs populations connaissent la même régression que celles papillons diurnes.
*Frederic archaux Dans l’intimité des papillons
Qui sont les papillons les plus grands et qui sont les plus petits ?
La plupart des papillons ont une taille moyenne qui peut aller de 25 mm à 40mm, mais certaines espèces peuvent être beaucoup plus petites et d’autres beaucoup plus grandes .
Les plus grands
Le papillon qui a l’envergure la plus grande est l’Agrippine (Thysania agrippina). La taille d’un bout de l’aile à l’autre peut dépasser les 32 centimètres. La peintre et entomologiste allemande Maria Sybilla Merian lui a consacré dans les années 1700 une très belle planche dans laquelle elle montre le papillon dans tous ses états, de l’œuf à l’imago .
L’Agrippine est une noctuelle qui vit la nuit et qui passe ses journées à dormir sur les troncs d’arbres avec lesquels elle se confond grâce à sa livrée cryptique. Dans les régions où il vit, ce papillon est parfois redouté par les populations qui lui prêtent des pouvoirs occultes et maléfiques .
L’Agrippine est le papillon qui a la plus grande envergure, mais il est battu pour ce qui est de la surface des ailes par l’atlas (Attacus atlas). Ce dernier mesure aussi dans les 30 cm, mais il a des ailes bien plus larges et une forme étonnante qui impressionnent tous ceux qui le voient. Sa surface alaire peut dépasser les 160cm2. Sa chenille n’est pas mal non plus puisqu’elle peut mesurer jusqu’à 12 cm de long.
Originaire des forêts tropicales de l’inde, ce papillon n’a pas de trompe. Devenu adulte, il ne s’alimente plus et ne vit que 4 à 5 jours, le temps de trouver une femelle et de s’accoupler avec elle. La femelle vit un peu plus, 7 à 8 jours, car elle doit accomplir sa tache jusqu’au bout et pondre ses œufs sur l’une de ces plantes hôtes.
Les deux précédents étaient des papillons de nuit . L’ornithoptère de la reine alexandra qui est endémique de la Papouasie Nouvelle-Guinée est le plus grand papillon diurne connu à ce jour. L’envergure des femelles qui sont plus grandes que les mâles peut aller de 19 à 28 cm.
D’autres papillons atteignent des envergures de 20 cm comme le papillon comète de Madagascar (Argema mittrei), le papillon hibou connu sous le nom de Caligo, le morpho bleu (Morpho menelaus), le sphinx géant du bresil (cocytiusantaeus) ou le papillon empereur (Bunaea alcinoe) qui vit en Afrique .
En France le grand paon de nuit est le plus grand papillon. Certains mâles peuvent atteindre une envergure de 20 cm.
Les plus petits
Les plus petits papillons font partie de la famille des Nepticulidae puisqu’un grand nombre de ces micro-papillons ont une envergure de 3 à 5 mm et que certains d’entre ne dépassent pas 1 , 5 mm de long. les chenilles de ce papillon de type mineuse vivent à l’intérieur des feuilles et se chrysalident dans un minuscule cocon .
L’azuré du Sinai avec ces 1, 3 mm d’envergure est aujourd’hui considéré comme le plus petit papillon du monde.

En France plusieurs membres de la famille des Lycènes comme l’azuré de la sarriette (Pseudophilotes baton) le cuivré de la bistorte (Lycaena helle), l’Azuré de l’ajonc (Plebejus argus) ou l’argus frêle (Cupido minimus) sont également très petits et dépassent à peine les 15 mm d’envergure .
Les petits papillons ont été rangés un temps dans la catégorie des microlépidoptères qui regroupent artificiellement les plus petits papillons. Cette catégorie regroupait autrefois des supers-familles comme les carposinoidea, les gelechioidea,les incurvarioidea, les nepticuloidea, les pyraloidea, etc ….. et s’opposait à la catégorie des macrolépidoptères qui regroupait les papillons de plus grandes tailles.
Elle n’est plus reconnue aujourd’hui par les classifications actuelles.
Étymologie de l’ordre des lépidoptères
Lépidoptère est l’ordre qui regroupe l’ensemble des insectes qui ont des écailles sur le corps et notamment sur les ailes, c’est-à-dire les papillons. On ne les voit pas forcément à l’œil nu, mais les écailles des papillons apparaissent très nettement dès qu’on utilise un fort grossissement.
Le terme lépidoptère vient du latin « lépidoptera » qui descend lui-même du grec ancien « λεπίς » (lepis) « écaille » et « πτερόν » (ptéron) « aile ».
Le mot « papillon » est un dérivé du latin « papilio » qui vient lui-même de la racine latine « pil » qui signifie « aller , ou vaciller » .
« Papilio » serait né du redoublement de cette racine qui donne une sorte d’onomatopée imitant le battement des ailes du papillon .
On retrouve d’ailleurs ce style d’onomatopées pour décrire le papillon dans les autres langues.
On dit farfala en italien.
Schmetterling en allemand
Butterfly en anglais
Mariposa en espagnol
Papallona en catalan.
Borboleta en portugais.
Parpaillo (Parpalhhol) en occitan.
Ou balafenn en breton.
Les Romains reprirent le nom « Papilio » et baptisèrent ainsi des tentes qu’ils utilisaient à la guerre, car la forme des rideaux qui se trouvaient à l’entrée rappelait la forme du papillon .
De là est né » le mot « pavillon » qui désignait à l’origine cette tente militaire romaine et qui est devenu synonyme de construction légère.
Autres descendants de « papilio », le mot « parpaillot » qui désigne des protestants ou le mot « Papilionacée » qui désignait autrefois la famille des légumineuses (aujourd’hui Fabacea) . Il est employé encore aujourd’hui pour parler des plantes qui ont des fleurs dont la forme évoque les ailes des papillons .
Pour expliquer le nom « parpaillot », certaines sources évoquent l’infidélité de certains protestants qui butinaient d’église en église. D’autres pensent que cela est une allusion aux protestants qui étaient brulés sur le bucher, car jugés hérétiques . Les papillons viennent parfois se bruler les ailes lorsqu’un feu brule la nuit .
On comprend la raison du mot « papilionacée » dès que l’on voit la forme des fleurs qui ressemble à des papillons « papilionacé »
« Minute papillon » : je ne pouvais pas passer sous silence cette expression qui trouve son explication dans le mouvement souvent rapide avec lequel les papillons passent d’une fleur à l’autre.
Dans son ouvrage , « où les papillons passent -il l’hiver » l’entomologiste Patrice Léraut rappelle que « papilloniste » fut proposé par Émile Littré pour décrire le naturaliste qui se spécialise dans les papillons, mais que ce terme ne parvint pas à s’imposer . Le mot « Lépidoptériste » gagna la bataille . Il est toujours employé aujourd’hui pour nommer les spécialistes des papillons (lépidoptères).
Étymologie chenille
Le mot « chenille » vient du latin « canicula » qui signifie « petite chienne ». Ce nom a été choisi en raison de la ressemblance de la tête de certaines chenilles avec un chien.
(Photo chenille de la phalène)
Petit rappel
La chenille est le deuxième stade après l’œuf du cycle des lépidoptères qui est l’ordre qui regroupe les papillons.
Le développement complet passe par 4 stades .
1) l’œuf, 2) la chenille, 3) la chrysalide et 4) le papillon adulte qui est également appelé « l’imago » ou le stade imaginal.
En biologie, le terme imago ou stade imaginal désigne le stade final d’un individu dont le développement se déroule en plusieurs stades.
Le nom « imago » a été donné à la forme définitive d’un insecte en fin de métamorphose par le naturaliste suédois Carl Von Linné , car elle est alors à l’image (imago en latin) des parents.
